
ayamun CyberRevue de littérature berbère
ⴰⵢⴰⵎⵓⵏ, ⵛⵢⴱⴻⵔ-ⵔⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
141 numéros parus
26ème année
2000-2026

Dernière révision : 22/11/2025
Nouvelles publications :
Tura, ur am zik, yella Facebook:
Nouvelle publication des Editions Achab
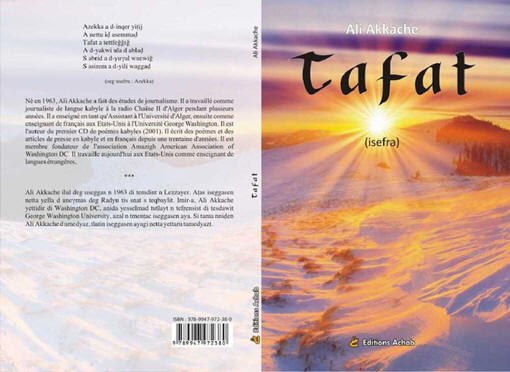
Publication
des Editions Achab,
Tizi-Ouzou :
Ramdane Achab : L'aménagement du lexique berbère de 1945 à nos
jours. Préface de Salem
Chaker. 350 pages.
Disponible en Algérie
« La
langue et la
mémoire » – Tameslayt d Wasal – éditions
L’Harmattan,
Collection « Présence berbère ».
Il
s’agit du quatrième
livre sur les énigmes kabyles – Yiwet tirgit yeccur axxam – Tamsaâreqt.
Une seule braise
éclaire la maison – L’énigme.
Savourons
la portée
allégorique et ô combien riche de sens de cet énoncé qui
définit si bien
l’énigme kabyle.
Aumer
U Lamara vient
de
sortir aux Editions Achab (Tizi Ouzou) un roman en kabyle, Timlilit
di
1962
. Tout débute à partir d'une photo de maquisards, comme ces
milliers
de clichés anonymes pris dans les maquis. Des photographies
qui figent pour la
postérité des hommes parfois inconnus ou oubliés. L’auteur
revient ici sur
l’histoire de ce roman.

Timlilit di 1962 est un roman basé sur un fait historique réel qui s'est déroulé au printemps 1962, soit quelques jours seulement après la signature du cessez-le-feu en Algérie…
L’histoire. La fin des sept ans et demi de guerre a rendu espoir à la population, laminée, usée et épuisée par les innommables épreuves qu’elle a subies. Dans le sillage de cet élan de joie libéré, un immense rassemblement de la population de Haute Kabylie a eu lieu, entre le 19 mars et la mi-avril 1962, dans la vallée de Bubhir. Partie d'un petit village des At Yehya, la foule avait grossi de village en village, de tribu en tribu pour se retrouver, telle une déferlante, dans cette vallée, Tazaghart, qui était quelques jours auparavant une zone interdite.
Parmi le groupe de maquisards qui accompagna cette foule se trouvait un officier de l'ALN, un des rares rescapés parmi les pionniers du 1er novembre 1954. Cet officier trouva les mots justes pour parler à la population, des mots pour panser les blessures et apaiser les souffrances immenses des sacrifices endurés par le peuple algérien ; il exprima ensuite les attentes et les espoirs sans limites de ce jour nouveau…
Bien évidemment, en ce jour d'avril 1962, il n'y avait pas encore le coup de force de l'armée stationnée au Maroc et ses milliers de morts (désigné à tort par «Guerre des wilayas»), le putsch de Ben Bella, l'invasion de la Kabylie par l'armée des frontières, la guerre des sables, le monopole du pouvoir par le FLN, l'imposition de l'arabo-islamisme, les injustices et les spoliations sans fin, le printemps amazigh de 1980, les massacres de milliers de jeunes en octobre 1988, l'apparition des barbes-FLN et de leur sous-produit l'intégrisme du FIS et de ses sous-traitants responsables des dizaines de milliers de morts, le printemps noir de 2001 et ses 121 assassinats, la corruption débridée et la vassalisation du pays envers les mirages des déserts orientaux...
Le roman
Près de vingt ans après cet évènement de 1962, Salem reçoit un email dans lequel était jointe une photographie qui avait été prise à ce rassemblement. Il eut beaucoup de mal à reconnaître, parmi les personnages de cette photographie, l'un de ses proches, qu'il venait de connaître. Salem, assis dans le hall d'embarquement de l'aéroport, fixa alors chacun de ces visages et essaya d'imaginer, en creusant dans ses propres souvenirs de la guerre et de la vie d'antan dans son village, le parcours de chacun des personnages qui y étaient alignés et certains souriant au photographe.
En partant de l'allure générale de chacun, de la coiffure, tête nue ou portant béret, de la tenue vestimentaire civile ou militaire, de l'arme au pied ou mitraillette en bandoulière, Salem ne tarda pas à mettre presque un nom, une famille et une histoire propre à chacun. Salem se retrouva tout d'un coup devant treize vies de combat, de souffrances et de mille espérances sur ce trajet sinueux qui les mena tous, aux sons des chants et des youyous, jusqu'à cette vallée de Tazaghart qui reprit soudainement vie.
Dans la confusion, entre le vécu et son imagination, Salem ne pouvait déterminer avec certitude s'il était acteur au milieu de ces personnages, dans les villages brûlés, les combats meurtriers, les centres de torture improvisés par les paras, les longues journées dans le silence des casemates, ou bien observateur distant, témoin malgré lui.
Lorsque Salem se leva de son siège dans cet immense aéroport pour prendre son avion, il ne savait plus si c'était bien lui ou un autre personnage qui avait emprunté son corps et son identité et se mouvait avec hésitation, dans le passé et le présent, le long des couloirs lumineux…
Salem entendait alors résonner dans sa tête quelques paroles de l'officier survivant :
"Nekmen achal di tesrafin akked tmara akken ad nedder, ad tedder tmurt nnaγ. Neffer di tillas γas nekkni nhemmel tafat. Nekna, nemmured di ddiq akken azekka ad bedden tiddi nsen warraw nnaγ, ad ddun d imdanen i tafat di tmurt nsen..." (nous avons tenu dans la contrainte et les casemates obscures pour pourvoir survivre et que puisse vivre notre pays, nous étions reclus dans l'obscurité alors que nous aimons la lumière plus que tout, nous avons rampé dans l'adversité pour que demain nos enfants puissent vivre debout dans leur pays...).
A. U. L.
Murad
Irnaten, Di lǧerra-k ay awal… (ammud n tullisin), Tazwart
n Kamal Bouamara.
Distribution : El-Amel, L'Odyssée et Chihab.

Ilemẓi n tmurt Iqbayliyen, Yahia, pas de chance de Nabile Farès, traduction kabyle de Remḍan Achab , aux éditions Achab :
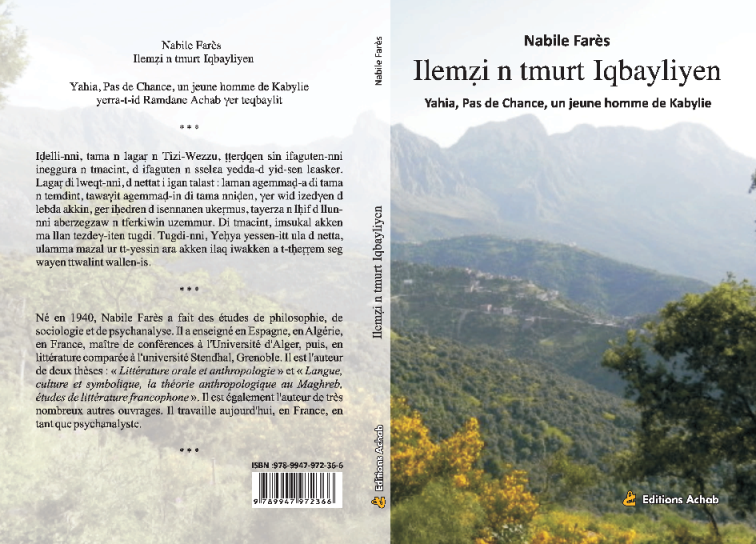
Yiwen wass deg tefsut, ungal nniḍen, wis 5, sɣur Ɛ.Mezdad, d wis sin deg 2014
Taduli d wis 4 :
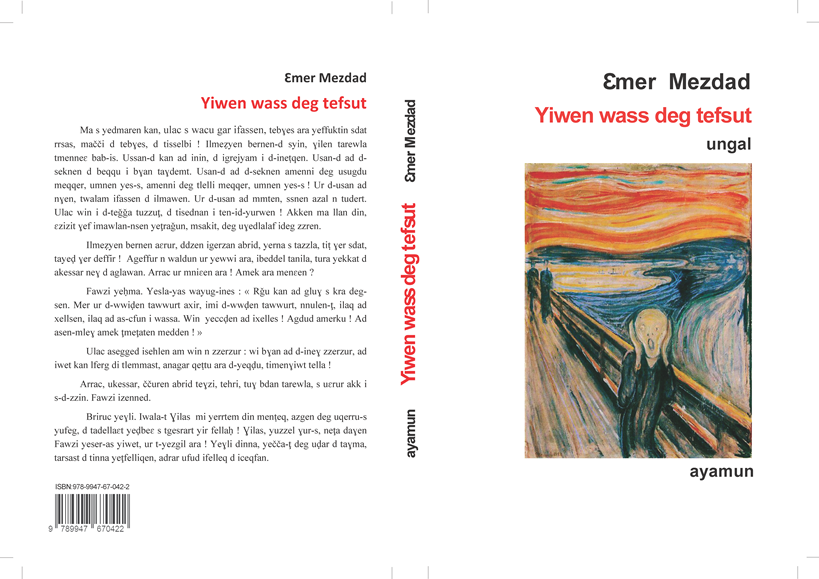
Ɛmer Mezdad
Yiwen wass deg tefsut
Ma s yedmaren kan, ulac s wacu gar ifassen, tebɣes ara yeffuktin sdat rrsas, mačči d tebɣes, d tisselbi ! Ilmeẓyen bernen-d syin, ɣilen tarewla tmenneɛ bab-is. Ussan-d kan ad inin, d igrejyam i d-ineṭqen. Usan-d ad d-seknen d beqqu i bɣan taɣdemt. Usan-d ad d-seknen amenni deg usugdu meqqer, umnen yes-s, amenni deg tlelli meqqer, umnen yes-s ! Ur d-usan ad nɣen, twalam ifassen d ilmawen. Ur d-usan ad mmten, ssnen azal n tudert. Ulac win i d-teǧǧa tuzzuţ, d tisednan i ten-id-yurwen ! Akken ma llan din, ɛzizit ɣef imawlan-nsen yeţraǧun, msakit, deg uɣedlalaf ideg zzren.
Ilmeẓyen bernen aɛrur, ddzen igerzan abrid, yerna s tazzla, tiṭ ɣer sdat, tayeḍ ɣer deffir ! Ageffur n waldun ur yewwi ara, ibeddel tanila, tura yekkat d akessar neɣ d aglawan. Arrac ur mniɛen ara ! Amek ara menɛen ?
Fawzi yeḥma. Yesla-yas wayug-ines : « Rǧu kan ad gluɣ s kra deg-sen. Mer ur d-wwiḍen tawwurt axir, imi d-wwḍen tawwurt, nnulen-ţ, ilaq ad xellsen, ilaq ad as-cfun i wassa. Win yeccḍen ad ixelles ! Agdud amerku ! Ad asen-mleɣ amek ţmeţaten medden ! »
Ulac asegged isehlen am win n zzerzur : wi bɣan ad d-ineɣ zzerzur, ad iwet kan lferg di tlemmast, anagar qeṭtu ara d-yeqḍu, timenɣiwt tella !
Arrac, ukessar, ččuren abrid teɣzi, tehri, tuɣ bdan tarewla, s uɛrur akk i s-d-zzin. Fawzi izenned.
Briruc yeɣli. Iwala-t Ɣilas mi yerrtem din menṭeq, azgen deg uqerru-s yufeg, d tadellaɛt yeḍbeɛ s tgesrart yir fellaḥ ! Ɣilas, yuzzel ɣur-s, neţa daɣen Fawzi yeser-as yiwet, ur t-yezgil ara ! Yeɣli dinna, yečča-ţ deg uḍar d taɣma, tarsast d tinna yeţfelliqen, adrar ufud ifelleq d iceqfan.
''Yahti - Aɣerrabu n ugafa'' (Le voilier du nord) en librairie
Par Le Matin du 13/01/2015
Au milieu du 19e siècle, il y avait un groupe d'archéologues russes et anglais, partis dans une mission dans le nord. Un jour le destin leur a envoyé une grande surprise: ils ont trouvé un fossile d'un grand dinosaure.
Résumé de l'histoire:
Pendant cette époque-là, la guerre de Crimée (1853-1856) était au sommet. C'était un grand feu qui opposait la Russie à une coalition formée de l'Empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du royaume de Sardaigne.
Cette guerre a vite influencé sur le travail de cette petite équipe, qui était encore sur la côte de Lysefjord, sise à Ryfylke, dans le sud-ouest de la Norvège. Suite aux ordres de leur empire, les Russes ont décidé de transporter le fossile à Saint-Petersburg pour examiner cette "grande découverte".
La Société Royale de Londres ne lâche pas. Les Anglais persistent et décident de poursuivre le fossile. Un grand challenge s'éclate au golfe de Botnie en Finlande, et la course s'est, par la suite, poursuivie jusqu'à la Mer Baltique. D'ailleurs, c'est là où la dernière bataille a eue lieu entres les Russes et les Anglais. La fin de cette concurrence va vite se décider dans la ville de Porvo, à presque 50 kms au nord-est de Helsinki.
Les événements de ce roman graphique, de Ilpo Koskela, se déroulent en Finlande pendant la décennie de 1850. C'est un sujet autour de la construction des voiliers, qui s'appelaient ''Jähtit - Yacht'' dans le nord, pendant le 19ème siècle. L'atmosphère générale de l'histoire, c'est un aperçu sur la vie politique en Europe pendant La guerre de Crimée (1853-1865).
L'auteur. Ilpo Koskela est né en 1958. Écrivain, dessinateur et graphiste finlandais résidant à Oulu, en Finlande. Dessinateur de presse (Journaux et magazines) depuis plus de 30 ans. Une de ses plus longues histoires publiées dans les magazines, son roman graphique "Rajalinja", une histoire des jeunes footballeurs, publiée entre 2005 et 2009.
Koskela a également écrit et dessiné sept romans graphiques, dont Aleks Revel, une bande dessinée qui raconte une vie d'un aventurier estonien, souvent présenté comme une oeuvre remarquable de Koskela.
Le texte originale du roman graphique ''Aɣeṛṛabu n ugafa'' a été publié en finnois, en 2007 (Permeren Jähti). Une année plus tard, la traduction en anglais va paraître (Jähti- Sailing Ship of the North). En 2010, il a publié, pour la première fois en Finlande depuis plus de 20 ans, un guide pédagogique riche pour les artistes et les dessinateurs de bande dessinée (Sarjakuvantekijän Opprilirja). Actuellement, il s'apprête à achever une nouvelle édition de ce livre, nrichie avec des nouvelles techniques de la bande dessinée.
En ce qui concerne le travail académique, Koskela a travaillé comme enseignant de de la bande dessinée à l'école d'art de Oulu, et cela depuis plus de 14 ans. En outre, il a donné plusieurs conférences dans le monde, dans des intituts et des universités, sur les nouvelles méthodes requises pour réussir un travail de bande dessinée.
Enfin, ses travaux sont traduits en plusieurs langues, dont le suédois et le russe.
1-2- Le traducteur : Hamza Amarouche
Auteur, journaliste et traducteur littéraire algérien résidant à Helsinki, en Finlande, Hamza Amarouche, né en 1982, contribue pour plusieurs médias algériens et finlandais.
En mars 2014, il a lancé, pour la première fois en Finlande, un programme en tamazight à Helsingin Lähiradio 100,3 MHz, distiné aux berbérophones de la ville de Helsinki et de sa métropole. Ce programme a contribué, d'ailleurs à ce jour, à introduire aux finlandais la culture et la civilisation amazighe dans ce pays. Parmi les invités qui étaient présents à ce programme, il y avait des artistes et des auteurs algériens et finlandais, dont la chanteuse Stina, qui a interprété pas mal de chansons kabyles.
Le traducteur contribue souvent à la promotion et les échanges entre la littérature algérienne et celles des pays baltes et scandinaves, notamment en Finlande et en Estonie. On outre, il anime régulièrement des rencontres de rapprochement culturel pour faire connaître la culture et la littérature algérienne.
2- L'atmosphère générale dans roman:
L'auteur du roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'', vit à ce jour dans la ville de Oulu, le centre administratif, culturel et commercial de la Finlande du nord et du centre. Ilpo Koskela a vécu de près les histoires de la mer, ce qui lui permettrait par la suite de réussir un travail excellent, qui imagine un thriller sur fond de la navigation à voile.
Avoir passé plus d'un demi-siècle sur la côte nord-est du golfe de Botnie, cela se sentirait bien dans l'imaginaire de l'auteur, et puis dans son roman: l'atmosphère générale en Botnie pendant le 19 ème siècle, y compris d'autres détails, les langues parlés, la monnaie, les unités de mesure, l'aliment...etc.
Les Finlandais sont, en grande partie, un peuple qui aime beaucoup la lecture sur l'histoire de la navigation. Quand l'auteur était sur le point d'écrire une histoire sur ce sujet, c'était presque un travail de recherche à entamer.
Quand à la La guerre de Crimée (1853-1856), "elle a été vécue, en Finlande -qui fût encore un Grand Duché de l'empire russe- comme une profonde humiliation, car elle généra un fort ressentiment envers les puissances occidentales qui avaient pris la partie de l'Empire ottoman". Cela aussi joue son rôle pour décrire l'atmosphère et la vie quotidienne en Finlande pendant cette époque-là. D'une manière plus précise, ce sentiment d'être finlandais qui vit sous la domination de l'empire russe, une puissance qui était déjà engagé dans une guerre ouverte sur plusieurs fronts.
À vrai dire, La domination suédoise en Finlande auparavant, quant à elle, elle impose en continu ses incidences dans le roman. La langue, la monnaie...etc. Cette mixture de cultures propose aux lecteurs en langue amazighe une lecture exceptionnelle, car elle abrège, à travers les dialogues de l'histoire, un croisement remarquable et insistant de civilisations en Finlande.
Pour bien comprendre l'histoire du roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'', il faut d'abord avoir un aperçu sur la Guerre de la Crimée (1853-1856). Pendant cette guerre-là, le voilier, comme étant le premier moyen de transport à moyenne et longue distance, a énergiquement joué son rôle pour décider quelle partie dans cette guerre serait-elle la gagnante. Outre, les voiliers, à cette époque-là, transportaient, du même, les marchandises, les passagers, le courrier...etc. Comme ils étaient aussi utilisés pour la pêche en mer, les activités militaires et notament les batailles navales.
Enfin, l'auteur a bien réussi à trouver un lien entre tous ces indicateurs, en proposant une tringue dans l'histoire, elle va conduire par la suite, mettre l'accent sur le rôle des voiliers pendant la Guerre de la Crimée.
3- Pourquoi traduire en tamazight ce roman graphique?
Il existe dans le roman une esquisse exigeante du rôle des voiliers pendant le 19 ème siècle. On peut y voir quelques clins dans le voyage, quand les marins transportent un fossile, qui a été trouvé par des archélogues russes et anglais, du Golfe de Botnie vers le sud. On peut avoir une idée enrichie sur ce fossile dans les pages 34 et 36.
La navigation n'est pas le sujet unique dans le roman, vue que le croquis de caractères est consacré, en grande partie, à la vie des nobles de l'empire russe, comme à la culture et au mode de vie des marins dans le Golfe de Botnie. Cependant, le sujet principal, c'est le fossile.
À noter, au cours des années entre 1850 et 1890, il fût une grande concurrence qui régnait entre les capitales occidentales sur la paléontologie, comme étant une discipline scientifique qui étudiait les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives de ces études.
Cela est d'ailleurs un autre indicateur, qui enrichit le roman graphique ''Yahti - Aɣeṛṛabu n ugafa'' avec des notions scientifique, notamment quand on croise parfois un style qui liste fortement des événements historiques liés au voyage du baron russe Mikhail Fedorov, caractère principal dans le roman, et les deux marins finlandais: Henrikki Wanha et Frans Rousu.
Comme ceci, Cette combinaison de dendrites va assurément créer une bonne intrigue tout en emmenant à décider une bonne sortie du roman. Le fossile dans le roman, est, donc, une piste sur laquelle les événements se déroulent, cependant, ce sujet reste sougnieusement lié au voyage des marins à partir du Golfe de Botnie, jusqu'à La Mer Baltique.
Ce roman ''Yahti - Aɣerrabu n ugafa'' s'inspire largement de ces croyances citées dans le livre ''De l'origine des espèces'' de Charles Darwin. Dans ce livre, Darwin mentionne ces '' différents prédécesseurs, à la fois concernant l'idée de «descendance avec modification» et l'idée de sélection naturelle dans une Notice historique ajoutée à partir de la troisième édition''.
Koskela, profite de ce livre pour en justifier, en partie, que l’histoire des espèces pourrait être, d'un autre vision, un terrain de pensée, comme être représentée, sous la forme d'un arbre schématique qui montre, dans un procédé confié à la fiction, les relations de parentés entre des groupes d'êtres vivants. Cela se voit souvent dans le texte, sous forme d'un ensemble de dialogues, naturellement évoqués, notamment par des caractères secondaires dans le roman.
D'autre part, La guerre de Crimée, l'histoire des pays du nord, les fossiles et la paléontologie, sont tous des textes presque inexistants dans la littérature amazighe. Cela pourrait fortement ajouter, en terme de sujets, un bon plus pour notre littérature. Il reste que ce travail constitue, en premier lieu, un grand pari par rapport à la diversité de procédés et de sujets dans le même roman. Outre, cela aussi par rapport au croisement de cultures et de civilisations entre les pays nordiques et l'Afrique du Nord Amazigh.
4- Les valeurs dans le roman:
La valeur culturelle: Au milieu du 19e siècle, la Finlande fût un grand-duché autonome de l'empire russe, et pour cela, le Royal Navy, composante maritime de l'armée britannique, décida d'attaquer la Finlande à partir de la mer Baltique. L'objectif de cette traduction en berbère est, en grande partie, d'ouvrir aux lecteurs en tamazight une fenêtre sur la vie quotidien en Finlande sous la domination de l'empire russe. Le but est aussi, d'introduire l'idée générale comment est-ce qu'ils vivaient les finlandais dans le nord, et comment fût-il leur mode de vie: Les moyens de vivre, la nature du pays, les relations humaines, le commerce, ... etc.
Dans le texte il existe aussi une valeur pédagogique, elle s'agit de décrire et d'enseigner les éléments du voilier pendant cette époque-là, De plus, l'expérience et les compétences des marins en Finlande (Page de 24 a 27).
Il y a encore une autre valeur, elle vise à transmettre un message sociale sur les traditions et les coutumes des peuples nordiques. Enfin, une valeur humaine. Cela se voit simplement dans les complots éternels qui résident naturellement dans l'âme de l'être humain. C'est une conjoncture ardue qui finit souvent par détruire les moralité. Le résultat serait clair par la suite, aucun vainqueur! (page 108).
C.P.
Aux éditions l'Harmatan :
Amar Ameziane publie Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle :
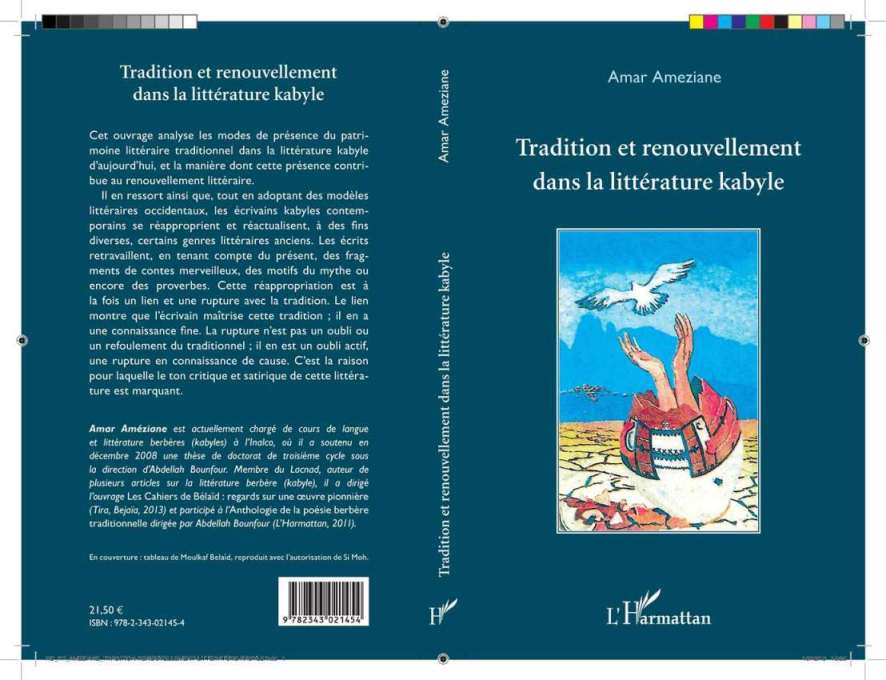
Au Maroc :
Le premier roman amaziɣ en français n'est pas algérien, n'est pas kabyle. Il est marocain. Rien ne serre de courir..... Il s'agit de "Aɣrum n ihaqqaren" ( "Le pain des corbeaux") de l'écrivain marocain Lhoussain azergui, Casa Express Editions..
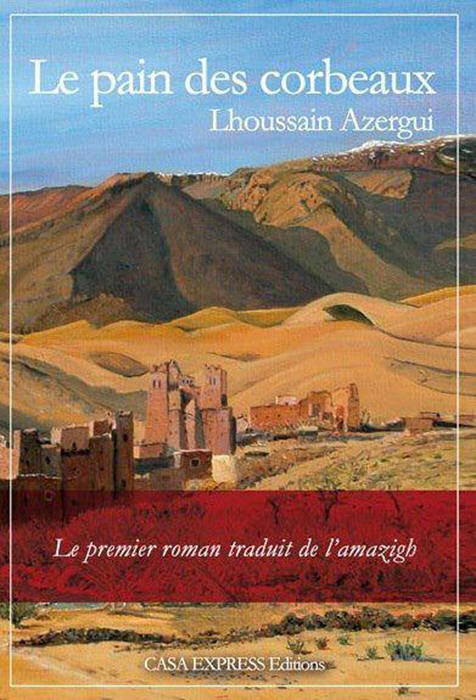
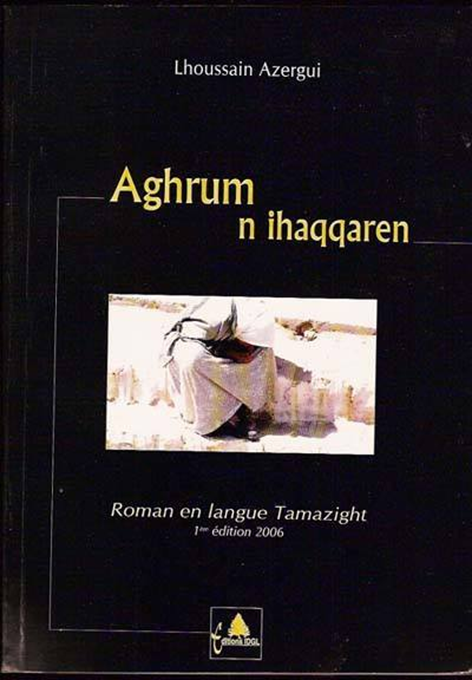
Paraît également au Maroc aux Editions berbères "Iɣed n tlelli", toujours de Lḥu Azergui
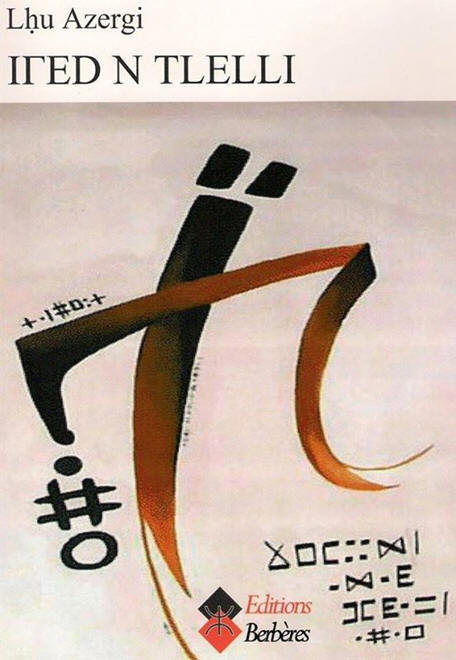
Smail Medjber a publié dans Club du livre amazigh : https://www.facebook.com/ :
Un excellent ouvrage à lire :
Uḍhir Uffir ou la poésie de l’instantané.
Auteur : Belkacem Ihijaten
Belkacem Ihijaten, le très talentueux poète kabyle a encore
frappé un grand coup avec son recueil, Uḍhir Uffir (À
travers la brume). Et c’est le moins que l’on puisse dire.
Publié chez L’Harmattan, il y a quelques temps déjà, il se
lit d’une seule traite. Tellement il est élégamment simple !
Dans le sens positif du terme bien naturellement. Ne dit-on
pas que faire simple est on ne peut plus difficile et ardu
?
En tous les cas, à titre personnel, j’ai beaucoup aimé cette
œuvre de M. Belkacem. Car elle m’interpelle à plus d’un
titre. De par les sujets qui y sont traités, mais aussi de
par cette conscience identitaire kabylo-amazighe qui la
traverse d’un bout à l’autre. Je dirais même qu’elle en est
l’ossature plus que visible. Ce à quoi je suis bien sûr très
sensible, car je suis moi-même amazigh.
Les poèmes ont tous la même forme : des strophes de neufs
vers ou des neuvains. Ils sont comme des impressions
poétiques produites par une inspiration fortuite que le
poète griffonne, de son aveu même, sur un morceau de papier
pour ne pas les oublier. Au fur et à mesure une œuvre tout
entière se met en place. Il ne reste qu’à relire le tout
pour le publier. M. Ihijaten est ainsi et restera
probablement toujours ainsi : un poète de l’instant et de
l’immédiat par excellence.
Quid des sujets traités dans ses poèmes ? On y trouve du
tout. Mais son pays y est une obsession permanente. En
commençant par son village natal, Gendoul. Ensuite, la
Kabylie qui a une place de choix dans ses écrits. Et enfin,
l’Algérie, cette grosse entité politique en plein milieu de
l’Afrique du Nord qui englobe tout ce beau monde. Quant au
style, je ne vous le cache pas : par moment, il est par trop
déroutant. Même si à titre personnel, j’y trouve bien
évidemment les accents de la légende poétique amazighe, Ssi
Mohand Ou Mohand. Ce qui est tout à fait normal. Ses poèmes
ont bercé de bout en bout toute la vie de l’auteur. Comme
tout Kabyle qui se respecte.
Mais, chose étrange, par moment, le ton général me rappelle
non pas celui d’un poète quelconque, mais précisément celui
d’un écrivain bien connu, je veux parler de Nietzsche,
particulièrement dans son œuvre magistrale, Ainsi parlait
Zarathoustra. Ce qui donne aux textes de M. Ihijaten une
aura très joliment spéciale et particulière, si je peux dire
les choses ainsi.
Pour davantage rendre accessible son texte aux lecteurs
non-amazighophones, M. Ihijaten a tenu à ce que ses poèmes
soient tous traduits dans un français plus que châtié qui
révèle, à mon humble avis, l’essentiel de sa magie poétique.
Comme quoi, chers lecteurs, vous n’avez plus aucune excuse
d’aller vous procurer, illico presto, le recueil et le lire
! Je suis sûr et certain que vous n’allez jamais le
regretter.
Lahsen Oulhadj
|
www.kabyle.com |
Timlilit Tis 8 N Tmedyazt tamaziɣt N Sumam ara ad yilin gar 25 ɣar 28 Jember 2014.
Amsayer, Le prophète de Khalil GIBRAN, Tazwart d taggara sur uselkad, Préface et postface de Youcef Allioui.
Khalil Gibran yella seg’mezwura ifkan udem agraɣlan i tisula taârabin
di taggara n usedwas wis XIX, akken yella daɣen d-anaéuô n tmeslayt
tagnizit. Mi yura s taârabt, yerra-d s timad-is ar tegnizit aîas seg’wayen
yura. Deg’wayen i d-yessufeɣ, imùeɣriyen fkan-as udem ilaqen. D-acukan,
p-puffɣa n The Prophet, deg’wseggwas n 1923, is ifkan amâaceô
ameqqwran ar medden, ugar deg’wemval utrim, naɣ di timura umalu.
Deg’wayen yakw yura s tegnizit, The Prophet (Amsayer) id ibanen amzun
p-paâencuôt-is naɣ d-Aɣella-n-tsuli-ynes. Di tazwara, yura s taârabt
amayeg amezwaru n wedlis-agi s-uzwil “Ennbi”. Mi yeggwev mraw-semus
iseggwasen. iseggem-it, irna-yas lqedd di tira snat tikwal. Almi i
d-amayeg wis-qrav s taârabt i d-yerra avris-nni ar tegnizit. Qqaren daɣ,
almi i-t isules qué iberdan bac yefka-t i wmaérag. Acuɣer akken, i-mi ibɣa
ad ifk yiwen wudem naɣ amayeg ifulken i wevris-is. Af-ayen yenna :
« Acku, bɣiɣ yal awal deg’wedlis-agi ad yili d win ilaqen deg’wemkan
ilaqen mebla ma ufiɣ amkan-nniven yifen win akken is fkiɣ ».
Khalil Gibran fut parmi les premiers à donner ses lettres de noblesse à la
littérature arabe à la _ n du XIXe siècle. Il a également été un grand écrivain
de langue anglaise. Il a traduit en anglais tous ses écrits en arabe. The
Prophet est son chef-d’oeuvre. La première version serait rédigée à l’âge
de quinze ans. Version qu’il remania plusieurs fois avant de traduire le
texte en anglais. Il voulait que chaque mot soit la plus belle parure du
langage. Le texte ne fut remis à l’impression qu’une fois qu’il jugea son
contenu à l’épreuve des nuances et des sentiments qu’il souhaitait donner
aux mots. Un peu comme s’il voulait sentir leurs racines. Il savait qu’il
suffisait parfois d’un mot pour faire surgir par magie l’espoir et les rêves
de tout un peuple. Paru en 1923, The Prophet lui conféra une notoriété
internationale.
Yusef Uciban Alliwi yella d-ademsan send ad yuɣal d-anmegdal
d-asnalsan-aùmetan i lmend n tutlayt tamaziɣt d-igerrujen yufa di
tmeslayt taqbaylit. Yura kra n yedlisen af tisula timaziɣin n Tmawya
taqbaylit yakw d kra imagraden yaânan daɣen idles amaziɣ n
Tmawya. Yesɣer tamaziɣt di tesdawit, ikcem timura m_medden
bac ad iwali d-acu yellan deg’idles amaziɣ.
Youcef Allioui est psychologue sociolinguiste. À travers la traduction du chefd’oeuvre
de Khalil Gibran, il nous livre un texte kabyle riche et dense, avec la sensibilité
et la passion qu’on lui connaît pour la langue et la culture amazighes de Kabylie.
Aux éditions ACHAB : blog des éditions Achab : leseditionsachab.wordpress.com
Nouvelle publication des Editions Achab, Tizi-Ouzou, Algérie :
Ramdane Lasheb :
Lgirra n 1954-1962 deg tmedyazt n tilawin.
Disponible en Algérie seulement. Distributeurs : L'Odyssée,
El-Amel et Chihab.
Une étude, rédigée en kabyle, de la poésie féminine
consacrée à la guerre algérienne de libération. L'ouvrage
comprend également un corpus de poèmes composés par des
femmes kabyles pendant la guerre, sur la guerre.

Madelaine ALLAIN, Lucienne Brousse
Tizi Wwuccen
Méthode multimédia de Tamaziɣt (kabyle)
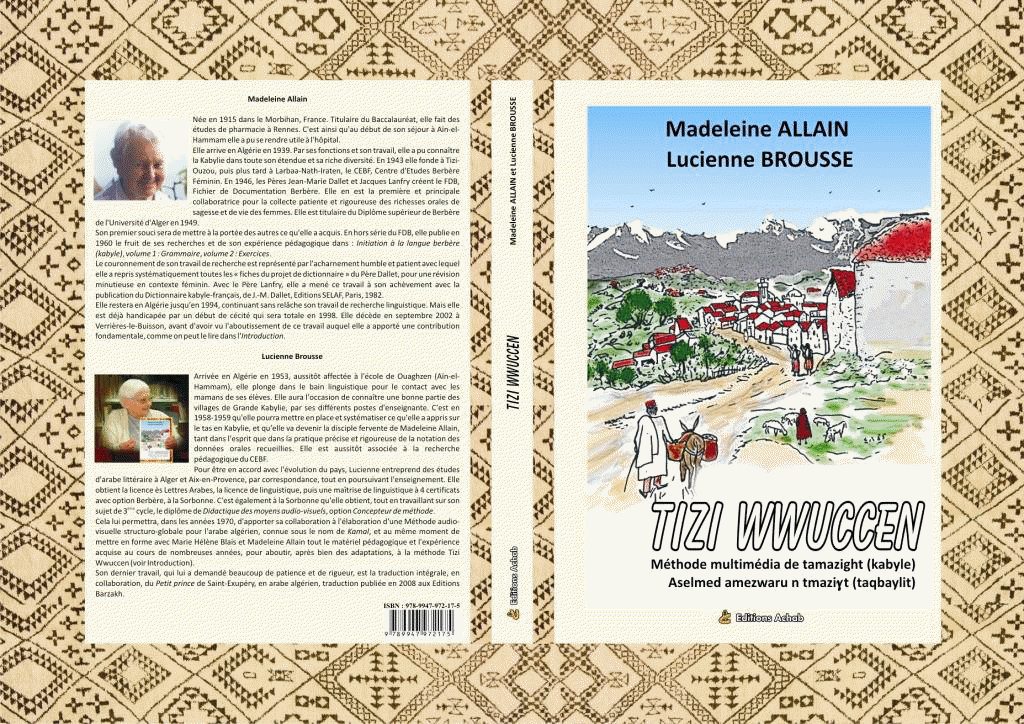
Camille Lacoste-Dujardin
La Kabyie du Djurdjura
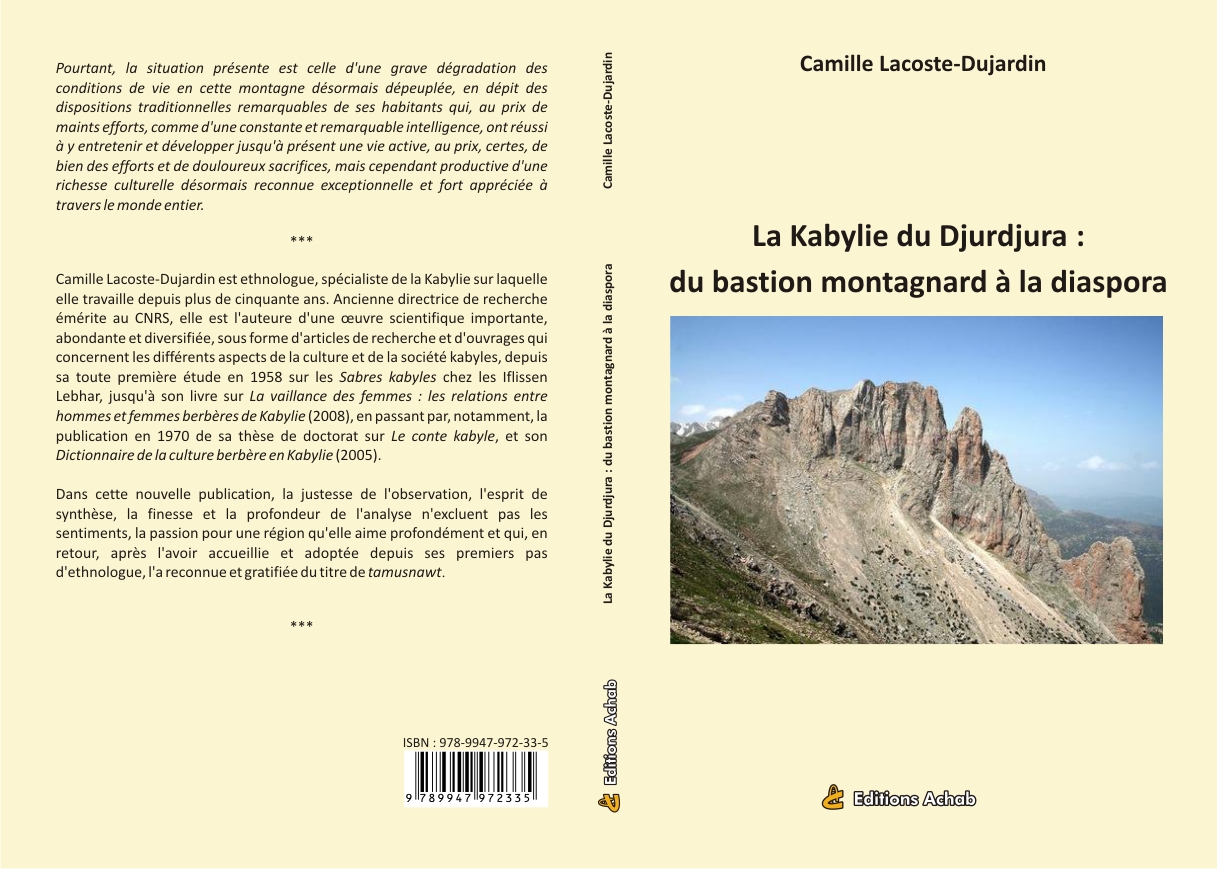
AMEZIANE KEZZAR,
Brassens, Tuɣac d isefra
"...Ahat yibbwas a d-taseḍ ɣur-i, ad iyi-d-tiniḍ ''Teḍra-d yid-i twaɣit."
Ɣur-k
18 iseggwasen. Walaɣ-k teţruḍ. Teţruḍ
imi k-teǧǧa tmeddakwelt-inek. Teǧǧa-k yerna
ahat di yir
tagwniţ. Nek a k-iniɣ:
"Ur ţru ara,
a mmi.
U lacdeg- s."
"D acu i gweεren, yuεar m'ara tiliḍ d agrud, ruJ:ient-ak tlabbilin-inek neɣ
teṭerḍeq-ak tcuffeţ -inek tamezwarut. Yezmer lḥal tacuffeţ-nni tetṭerḍeq i
lebda, d acu nekk ini,ggummaɣ ad ţuy.Maεnii diɣen, cwiṭ cwiṭ,
kulci yers
deg wul-iw. Gmiɣ
d s wannect-agi. Rnu diyen, deg
yimiren ar
ass-a, ḍrant-d
yid-i tlufa-nniḍen, am
taluft-agi-inek. Ad ḥebseɣ dagi, imi nekkini, ccɣwelinu t-turart s wawalen.
D acu diɣen, ulamma nniɣ-ak-d akka, anda tetɣileḍ
ur ḥulfaɣ ara
s tedyant-agi-inek, degmidɣa i uriɣ fell-as taɣwect.Twalaḍ
?"
Georges
Brassens
Georges Brassens, d acennay
afransawi,
ilul di Sète,
ass n
22/10/ 1921, yemmut ass n 29/10/
1981di Saint-Gély-du-Fesc.
Ameziane Kezzar,
ilul deg wseggwas 1962 di taddart n
Maraɣna, di
tmurt n
Leqbayel.Yura s teqbay lit Ayyul
n Ganǧis, s
tefransist, La
fuite en avant.
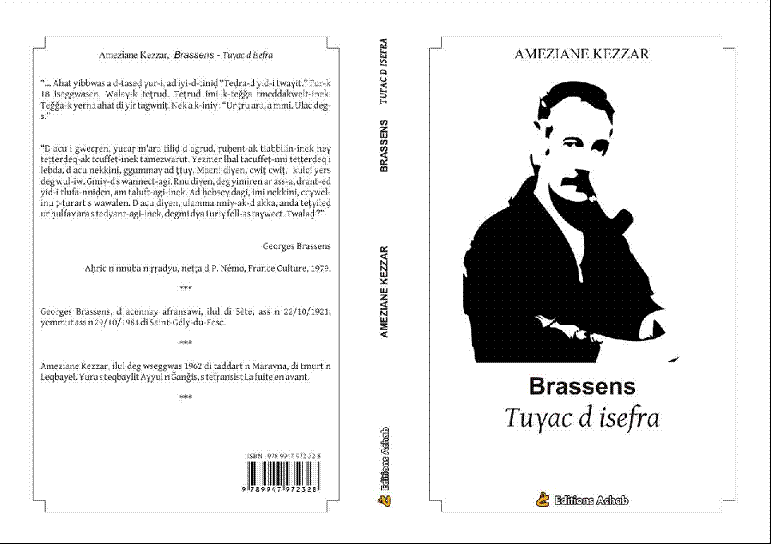
Hend Sadi, Mouloud Mammeri, ou la Colline
emblématique
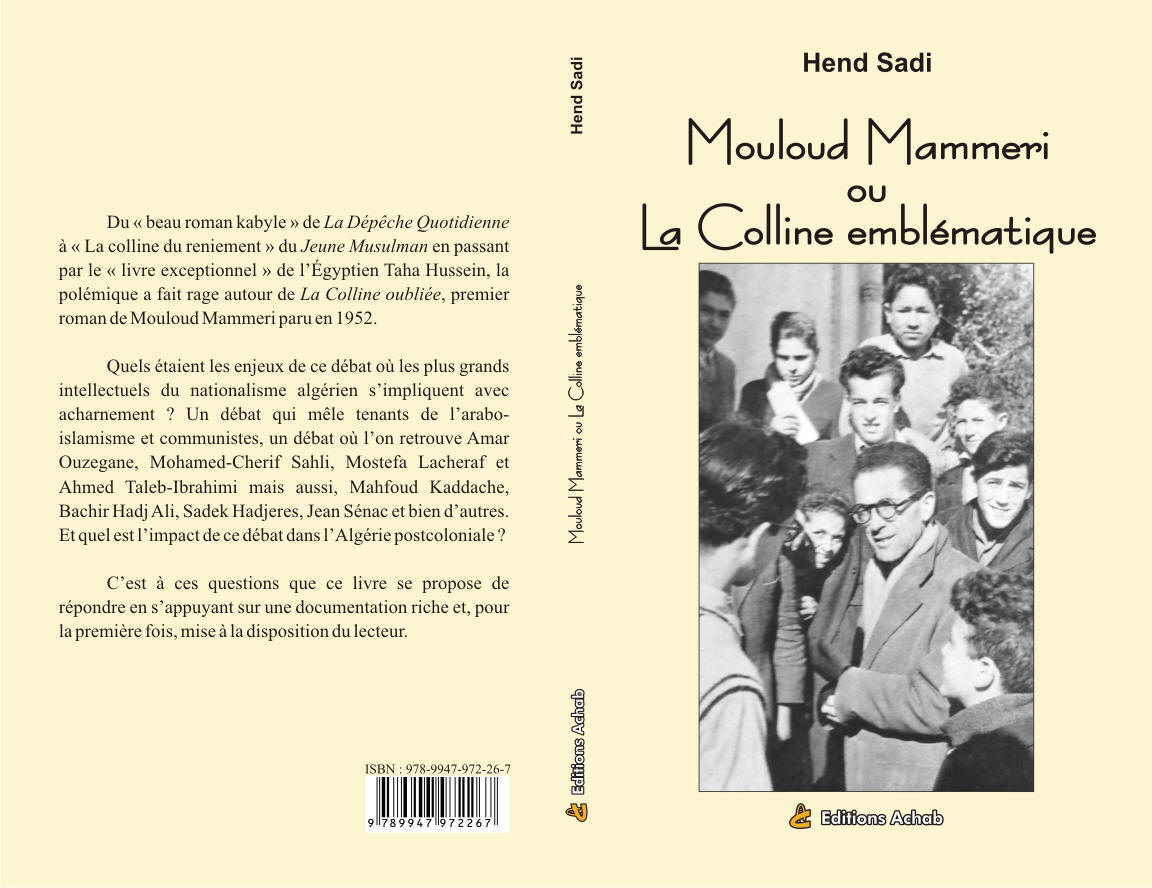
Aux Editions Ayamun :
Nouvelle publication
d’Amar Mezdad
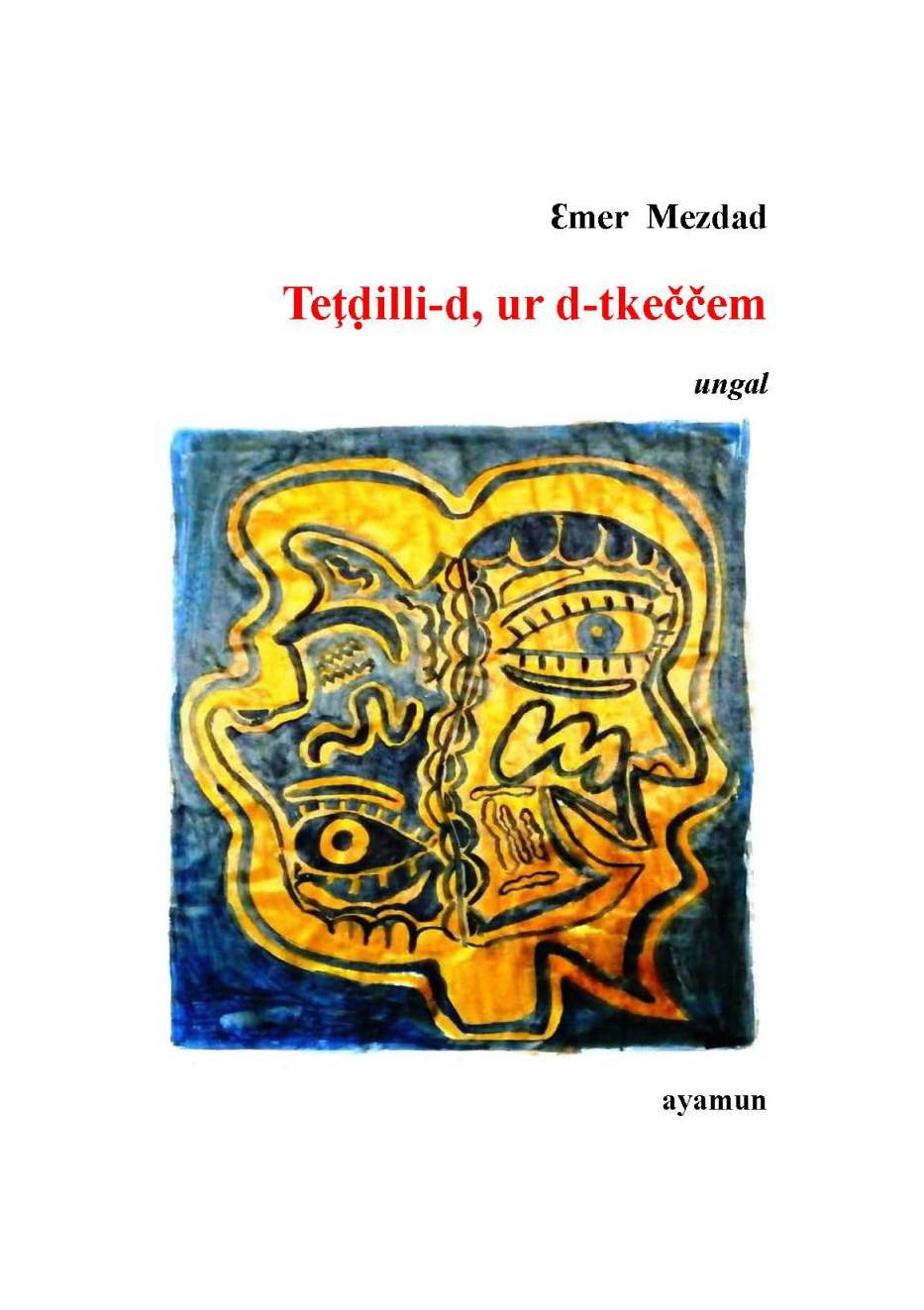
Tettdhili, ur
d-tkeccem, par SOA, DBK
9/03/2014
L’auteur de,
‘’Idh d wass’’,
‘’Tagrest urghu’’ et ‘’Tughalin’’, vient d’enrichir la
bibliographie kabyle
d’un nouveau roman. En effet, Amar Mezdad, le Balzac
kabyle, édite chez
‘’Ayamun’’, au grand bonheur des épris de la littérature
amazighe, ‘’Tettdhili,
ur d-tkeccem’’ (on l’entrevoit, mais il (ou elle) n’entre
pas). Cette nouvelle
publication est déjà en vente. A rappeler que Amar Mezdad,
médecin de son état,
est aussi auteur de poésie de qualité dont
l’incontournable, et presque
mythique, poème ‘’ yemma tedda hafi ’’. Son avant dernier
ouvrage, ‘’Tughalin’’
(le retour) est un recueil de sept nouvelles.
SOA
Aux
Editions Odyssée :
1)
De la pédagogie de
projet et de l’enseignement
da la langue amazighe en Kabylie
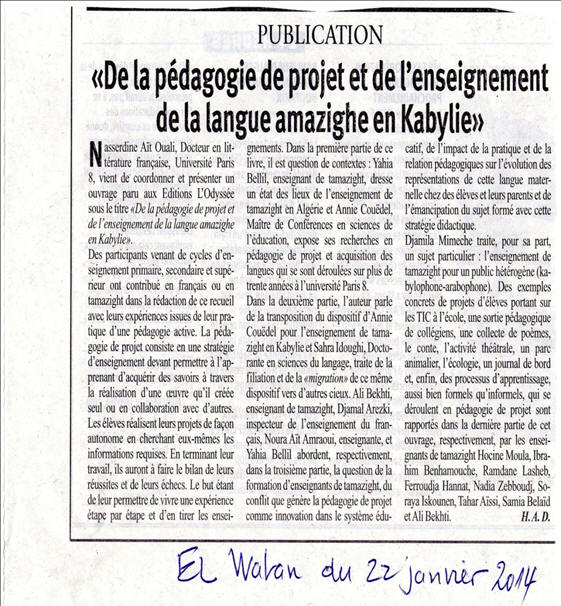
2) Chants de guerre des femmes kabyles[1]
3) Jadis, à At Douala[2],
présentés par
Nasserdine AIT OUALI, docteur en littérature
de l’université Paris 8.
Ce
sont deux ouvrages
littéraires, de Ramdane Lasheb, qui n’appartiennent pas au
même genre et qui
réfèrent à des espaces-temps différents. Les deux
publications ont toutefois en
commun le fait qu’elles se rapportent à notre mémoire
collective. La première
est un recueil de chants de guerre comme l’indique son
titre, avec une
particularité : des chants produits exclusivement par
des femmes. La seconde
publication consiste en ce qu’on peut apparenter à des
chroniques si on
considère que les croyances du monde auquel elles se
réfèrent sont des
« vérités »[3].
On peut aussi
considérer l’existence de ces croyances au sein de la
population comme un fait
social authentique. Mais l’ordre du déroulement des faits,
qui est une des
caractéristiques du genre, n’est pas respecté dans ce
recueil qui tient aussi
de la légende ou de l’anecdote. Cela rend ce livre difficile
à catégoriser d’un
point de vue générique.
Chants de guerre des femmes kabyles se compose
de 81 pièces en
version originale (kabyle) et leur traduction (français). Ce
recueil est
présenté par Ramdane Lasheb en français[4].
Cette poésie a
été recueillie auprès de femmes qui ont vécu la colonisation
et la guerre
d’indépendance. Les pièces 1 à 42 datent de 1954 à la fin
1959 et les autres
pièces de la fin 1959 à 1962.[5]
Il n’y a pas
d’indications plus précises quant cette organisation du
recueil (ordre
chronologique). Ce travail aurait sans doute gagné à être
organisé de façon à
offrir plus de lisibilité au lecteur.
Des chants sont composés pour
évoquer les visites des combattants ou les incursions des
soldats français dans
le village de Tala-Khellil. D’autres chants sont composés en
l’honneur de combattants
ou de martyrs. Des pièces sont consacrées à la torture et
aux tortionnaires, à
la traitrise et aux traitres. Un des thèmes de cette poésie
est aussi la
bravoure et l’héroïsme des combattants de la région qui sont
nommés (pour
certains). « Ces chants sont collectés
exclusivement dans un espace
géographique limité au seul village Tala-Khellil,
de la commune d’At
Douala, dans la
wilaya de Tizi Ouzou. »[6]
La séparation, la
mort, la désolation se mêlent à l’espoir d’une indépendance
(sujet du dernier
chant) pour laquelle sont consentis tant de sacrifices.
Cette poésie de résistance dans
son contexte de production constitue une source
d’information de premier ordre
pour les historiens ou ceux qui veulent connaître l’histoire
de la guerre
d’indépendance, ici, à At Douala. Dans une société de
tradition orale, dans un
pays qui n’a pas fini d’écrire son histoire, le recueil
établi par Ramdane
Lasheb est une contribution à cet exercice, en plus de sa
dimension littéraire.
La lecture de cette poésie inspirée par une tragédie ne se
rapporte pas
seulement à la dimension intellectuelle ; l’esthétique
du
« tragique » qui caractérise ces chants fait
(re)vivre, avec beaucoup
d’émotion, une période historique douloureuse qui constitue
une part de notre identité
collective (et individuelle pour beaucoup). Ainsi, cette
littérature orale et
populaire, qui a servi la cause des partisans de
l’indépendance de l’Algérie
lors de la guerre de libération, comme le souligne Ramdane
Lasheb dans sa
présentation, assume d’autres fonctions : historique et
esthétique[7].
Jadis à At Douala est un recueil de
« chroniques »
recueillies par Ramdane auprès des anciens de son village
pour les fixer par
écrit après avoir emprunté la voie de la tradition orale.
Les textes qui
composent ce recueil sont courts (une à cinq pages). Le
texte est écrit
dans une langue qui rappelle le langage des anciens et des
montagnards qui ont
su garder une certaine authenticité au code linguistique du
kabyle, une des variantes
de tamazight. Ces textes nous font revivre aussi des codes
socioculturels qui
ont du mal à survivre face aux acculturations chroniques
dont nous souffrons
depuis des siècles, altérant par la même occasion notre
identité amazighe. La
simplicité du texte ne diminue en rien sa qualité
esthétique. Cela est, au
contraire, un plus pour le lecteur qui est épargné par
l’usage de néologismes,
d’emprunts aux autres variantes ou d’archaïsmes que certains
écrivains
utilisent à profusion dans leur écriture, rendant leur
textes rébarbatifs pour
les non initiés à ces usages lexicaux. Ces compositions avec
de telles
recherches lexicales ont sans doute pour intention d’élever
la qualité
esthétique des créations et de contribuer à l’enrichissement
de la langue mais
restreignent leur lectorat. Les « dosages » sont
parfois
excessifs ![8]
Il ne faut pas
oublier que la lecture est un moment de détente et de
plaisir pour la majorité
des amateurs de textes littéraires.
La
lecture de ces récits, où la prose
côtoie la poésie, réfère à une époque d’une société où la
superstition est
omniprésente. Les croyances en des pouvoirs, parfois
surnaturels, de certains
personnages comme dans « At Bu3li »[9]
lorsqu’un pèlerin
implore Sidi Khaled Abdellah qui va sauver leur paquebot en
naufrage sans que
son corps ne quitte son village et alors qu’il dirigeait la
prière à la
mosquée. Nous pouvons aussi y rencontrer du merveilleux
comme dans
« Tamaghucht »[10]
avec un
« berger » surpris dans son sommeil alors que des
perdrix
l’épouillaient et des chacals veillaient sur son troupeau.
Ce
qui se retrouve le plus
souvent dans ces textes c’est la malédiction qui s’abat sur
des personnes qui
commettent du mal. Elle touche aussi des espaces comme des
villages, notamment
lorsque ses habitants s’adonnent à des actes qui méritent
une « vengeance
divine » que réclament des gens simples (victimes de
méfaits) qui sont
trop faibles pour se défendre ou se venger. Parfois, ce sont
des
« walis » qui intercèdent pour que les méchants
soient punis. Ainsi,
des villages sont décimés[11]
ou désertés[12].
Ces
« légendes » ont évidemment une visée éducative
puisqu’elles visent à
inciter l’homme au bien en lui donnant des exemples de
méchants qui ont
chèrement payé leurs méfaits.
Ces malédictions qui ont des
origines lointaines dans ces textes sont ancrées dans la
mémoire collective et
certaines sont toujours « vivantes ». Ainsi, un
des textes rapporte
un sacrifice et un pardon demandé, en 2002[13],
par des
descendants qui voulaient mettre fin à une malédiction
ancienne.
Les
deux livres appartiennent à
deux genres différents mais ont bien des choses en commun.
Ils participent à la
fixation de notre patrimoine oral et à la mise à la
disposition du lectorat
d’éléments pour étayer notre identité collective. Ces
ouvrages consacrés à son
village natal (et à At Douala) par Ramdane Lasheb
« collent » à la
passion de ce dernier pour l’archéologie.[14]
Il contribue à la
reconstitution du passé à l’aide d’éléments collectés auprès
des anciens et qui
seraient perdus à tout jamais avec la disparition de ces
derniers maillons de
la chaîne de transmission de la tradition orale.
Nasserdine AIT OUALI,
docteur en littérature de l’université Paris 8.
En
autoédition, sortie d'un
nouveau recueil de nouvelles en Kabyle: «
Di lǧerra-k
ay
awal »
(SIWEL) 27/12/2013
— « Di lǧerra-k ay awal » (Sur ta trace, parole) est un recueil de nouvelles qui vient tout juste de paraître aux éditions lulu.com (self-éditions sur internet) signé par Mourad IRNATENE, un jeune auteur kabyle. Il s’agit de sa toute première publication. Ce recueil de 166 pages contient dix nouvelles dont une nouvelle hyponyme : « Di lǧerra-k ay awal » à travers laquelle Mourad IRNATENE a rendu un hommage à l’immense auteur kabyle d’expression française et gardien de la parole, Mouloud MAMMERI, en prêtant cette même parole, dans sa nouvelle, aux personnages de ce dernier.
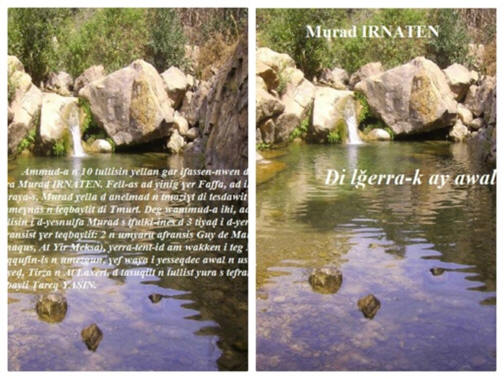
Di tullisin-a i aɣ-d-yugem Murad Irnaten si
tala n
teqbaylit-is, nessaram ur tettɣar ara, udmawen ulin isawnen,
ṣṣubben
ikesran, cerhen, nnuɣnan, run, ḍṣan, urgan akken llan
yemdanen
di tmetti taqbaylit. Meqqrit tirga-nsen akken meqqrit tirga
d lebɣi n
Murad Irnaten. Yal tullist d tanagit ɣef kra n tallit, yal
tullist d
timlilit akked uẓar n teqbaylit, d tamsirt si temsirin n
tudert, d tudert
i tutlayt taqbaylit.
On retrouve dans ce recueil: Di lǧerra-k ay awal ( Sur ta
trace, parole),
Nnaqus (la cloche) et At Yir Meksa (adaptation de,
respectivement, “le gueux”
et “Le saut du berger” de Guy de Maupassant), Nnif aderɣal (
l’honneur
aveugle), Teǧǧa-k tikli ay aḍar (Pied, la marche te
dépasse),
Yir tikli (Mauvaise démarche), Tadyant n Meqran (L’affaire
Mekrane), Amur-nneɣ
(Notre lot), Iles agugam (Langue muette), Tirza n At Laxert
(Traduction de la
nouvelle “Le retour des Maures” de Tareq Yassine”)
Ce nouveau-né littéraire, qui s’ajoute donc à la kyrielle
d’autres recueils de
ce genre littéraire si fécond, est complètement dédié à la
Kabylie. Dans cette
contrée chaque personnage prend vie dans une histoire
singulière, la sienne,
mais aussi dans l’histoire de quelques personnes proches ou
éloignées, et dans
celle du narrateur. L’auteur se consacre à ses souvenirs
d’enfance, mais aussi
à la difficulté quotidienne des habitants de cette contrée
martyrisée qui se
bat chaque jours becs et angles pour sa survie et son
existence.
Les titres des nouvelles sont révélateurs de cette rage
d’exister portée et
criée par chacun des personnages qui s’y meuve.
SIWEL
Aux éditions
ENAG :
Mohand akli salhi, Etudes
littérature kabyle, ed.
ENAG, 177 pages
SOMMAIRE :
La littérature kabyle dans le
contexte ciolinguisyiquealgérien
Le nom de la poésie en kabyle
La métrique chez Si Mohand
Langue
et et métrique.
Le cas de
Si Mohand
La
nouvelle
poésie kabyle
Les poètes d d'aujourd'hui
et Si
Mohand
Le roman kabyle
Nouvelle et texte oral délocalisé
le texte narratif
de l'enseignement
du kabyle : étude de deux manuels de lecture
Didactique du
texte littéraire en amazigh : manuels
de 3lème
et 4ième années moyen en Algérie
Terminologie
et enseignement de la littérature amazighc
(kabyle)
Notes de lectures
Aux Editions Achab :
Revue tifin, Mohia, esquisse d’un
portait, ed Acahab,
2012, 257 pages
MOHIA,
ESQUISSES D'UN PORTRAIT
Mohia nous a
quittés en 2004,
après une agonie, un combat difficile contre une maladie qui
l'a emporté à la
Fleur de l'âge.
Dans les
années 70-80 Mohia.était
une figure emblématique d'une littérature à la fois
populaire et
clandestine : en Algérie, ses
pièces étaient jouées et
répétées à l'insu des autorités algériennes dans les
campus
universitaires, ses
cassettes étaient dupliquées et diffusées sous le manteau ou
plutôt le burnous
;
en France
certains de ses textes
ont été publiés dans des revues militantes comme Tisaraf.
Il a monté une
troupe de
théâtre qui, dans les
années 80, a rencontré un franc succès auprès des Kabyles de
France.
Mais qui
connaît Mohia
aujourd'hui en Algérie? En France ? Qui a entendu dans la
nouvelle génération
ses
cassettes ?
Qui a lu ces textes,
trop peu nombreux, qu'il a publiés ? Qui pourrait dire qu'il
connaît l'œuvre de
Muhya ?
Pourquoi?
A la fin des années 80 et au début
des années 90,
Mohia a décidé de ne plus rien faire dans le monde des
« Brobros »,
des berbéristes
militants, notamment celui des intellectuels «brasseurs de
vents» par lesquels
il a
été très
déçu. Il sort alors de
l'espace « public » kabyle, celui qui ne parle pas sur les
ondes, qui ne donne
pas
son avis dans
lesjournaux, qui ne
publie pas : celui-ci n'existe plus.
Et c'est ainsi
que pendant plus
d'une dizaine d'années, Mohia n'a plus existé pour les
Kabyles. Jusqu'à cette
mort tragique
qui a fait fleurir
sur les ondes, sur la toile internet, et sur les papiers des
journaux, les
mémoires
et les pensées trop tardives pour
un homme de lettres
que l'on ne pourra pas ignorer dans les prochaines
années. Voilà
pourquoi nous
consacrons ce deuxième numéro de Tifm à cette
figure éminente dont
l'œuvre
gagnerait à être connue et
davantage étudiée.
Tifm
propose
à un large public un reflet de la
culture berbère à travers ses littératures orales et
écrites. La revue a deux
lectorats
: un public
berbère qui, à travers l'écrit, retrouvera sa langue et sa
culture d'origine,
et un publicfrançais ou
francophone
qui
souhaite en découvrir la vitalité.
Aujourd'hui,
la tâche
n'est plus simplement de recueillir une mémoire orale
menacée d'oubli. Elle est
de promouvoir
_-ie
littérature
berbère affranchie des tentations de la répétition et du
repliement, et qui
assume le risque de la
novation
et de
l'ouverture que permet l'écriture.
Cette
littérature à
découvrir est aussi, en quelque sorte, à inventer. Tifm
participe donc à
cette tâche en encourageant
la
réflexion sur les
littératures berbères dans son ensemble et tout
particulièrement sur les
nouvelles publications, et
en
réservant un
espace de création aux jeunes auteurs berbères.
Editions
Achab, Tizi-Ouzou, une nouvelle
publication :
Adaptation
kabyle
des Fourberies de Scapin, de Molière.
Aux Editions
Belles-Lettres :
Belheddad
Muhend-Tayeb, Refdeɣ
lzqlam ad aruɣ, ammyud n yisefra,40 pages
Timlilit n tɣermiwin, sɣur Djamel Benaouf
Tazwart
Yella yiwen westeqsi yezgan segmi
tebda Yemma-s n
ddunnit : Ma taẓuri ɣur-s iswi,
ma ɣur-s izen i yemdanen neɣ akken qqaren, ma taẓuri i tẓuri, ma tella kan i yiman-is? Ǧamal Benɛuf yerra-d
awal i westeqsi-yagi, imi tasekla ula d nettat d taẓuri. Ungal-ines ɣur-s yiwen wazal
aseklan meqqren, imi yesseqdec deg-s taqbaylit ifernen,
yessaf-itt, yessekcem
deg-s awalen imaynuten, yerna ɣas akken, yezmer
wemdan a t-iɣer s tefses ; maca annecta mačči d
ayen
yezwaren. Ungal-a yesskanay daɣen tamusni
umaru deg wayen yeɛnan akk tilufa
tigraɣlanin, ama d tasekla, d idles, d
amezruy neɣ d tasertit, ayagi yakk yurzen ɣer temsalt n yili neɣ n tamust Imaziɣen. Ugar ɣef waya, Ǧamal Benɛuf am wakken d agezzan imi yemla-d,
yessawel-d ɣef temḥeqranit
tameqqrant n yemdanen sɣur yemsulta
d tedbelt di tmurt, imi ayen yeḍran d wayen
iḍerrun ussan-a ɣur-neɣ, d aselkem n wannecta. Tasekla
dagi d asulef daɣen i umaru ad yessken tiktiwin-ines
ɣef ddunit. Maca tudert war tayri –
neɣ takesna - ur telli, ɣef waya iḥulfan-agi mmugen d tinelli n
wungal. Taggara d asirem,
d tiɣri i tayri ger sin yemdanen, maca
ahat i talsa
yakk.
Ǧamal Benɛuf yura
yagi isefra zeddigen yerna ttazzalen am waman, maca
ungal-agi d amezwaru-ines.
D amezwaru maca d tasmurest ara yeqqimen di tsekla tamaziɣt.
Kamal
u Zerrad
Yulyu
2001/2951
Djamel Benaouf
nous livre ici un roman où l’amour sert de toile de
fond à une œuvre
complexe mêlant l’histoire, la politique et la littérature.
Le récit, achevé il y a quelques
années, est ancré
dans la réalité quotidienne, avec ses combats contre
l’injustice, l’arbitraire,
le mépris et les abus de toutes sortes frappant les Berbères
– synecdoque pour
l’être humain – prémonitoires
de ce qui
se passe aujourd’hui en Kabylie.
Cette œuvre humaniste de Djamel
Benaouf fera date car
elle annonce indubitablement un tournant dans la littérature
kabyle naissante,
encore marquée par la quête identitaire. Elle
dépasse en effet la description romancée de la
revendication berbère,
abordant l’homme sous toutes ses facettes et décrivant
remarquablement les
sentiments d’appréhension ou de bonheur des deux
protagonistes amoureux.
Ce roman, écrit dans un kabyle
châtié, se lit avec
bonheur. Djamel Benaouf
est un auteur
avec lequel il faudra compter à l’avenir et qui, avec cette
œuvre, aura sa
place dans la littérature berbère.
Djamel Benaouf vit à Oran, loin de
sa Kabylie natale.
Militant dès son jeune âge de la cause berbère, il est
également l’auteur de
recueils de poésies en grande partie inédits. Ce roman est
sa première œuvre en
prose.
Kamal Naït-Zerrad*
*Professeur
des
Universités (langue et linguistique berbères) Inalco (Paris)
« Tamurt tuɣal
d Kayan »
Muḥya
|
Benaouf,
Djamel: timlilit n tghermiwin (approximately:
'City encounter') (Algeria) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||
|
|
||
|
Review |
||
|
Although
the first novel of Djamel Benaouf can be described
as a love story, love is in fact only one aspect
of this complex literary work bringing together
history, politics, literature and situating all
this in a big Algerian city of present days.
Completed already several years ago, the story
focuses on everyday life marked by the fight
against injustice, the abuse of power and the
denial of the Berbers’ right to their own cultural
identity of which the autochthonous people are
victims of. Moreover, in this novel Benaouf
anticipates what today is going on in Kabylia. Yidir
and Tudert, the protagonists of this novel, keep
their love to themselves, for they live in a
society in which showing emotions is very uncommon
as a result of strict traditions making people
internalise this concept of secrecy early in their
life. In addition to this, there are the
prohibitions imposed by fundamentalists and the
police which seems to collaborate with the
fundamentalists when making a check on young
couples walking hand in hand in the streets or
embracing in public.
At first the love story of Yidir and Tudert
is not to the fore of the novel, and the narrator
mainly describes the government’s repressive
policy towards Kabylian activists and the
reactions and demonstrations aroused by this.
Progressively the narrator’s attention shifts to
Yidir’s and Tudert’s fight for the recognition of
their Berber identity which finally, as the
narrator reveals, makes the two lovers show their
emotions openly. Their feelings of fear and joy
are described with remarkable sensitivity. Djamel
Benaouf is a promising author who undoubtedly will
make himself known in the future, for his literary
work represents an important change in Kabylian
literature in regard to topic, style and language.
Most noticeable is the change of topic. Up to now
novels and narratives written in Kabyle, the
number of such texts is rather low at present due
to reasons affecting all languages lacking
promotion and acknowledgement, have mainly focused
on the quest for identity – which in the first
place means condemning the cutting-out of Kabylian
culture – , social problems or love. Benaouf takes
a different perspective: Those aspects which have
been regarded as minor details so far in Kabylian
literature are moved to the centre of interest.
Thus, he explores the human side of the individual
and his experience as well as he deals with the
protagonists’ affection and closeness to each
other. Because of his intimate knowledge of Kabyle
language he is familiar with collocations and
expressions. At the whole, this renders his style
polished and full of nuances, and yet his novel
reads very well. In the context of Kabyle
literature it is also important to know that
Kabyle is spoken in a society which was
exclusively oral only several decades ago. Benaouf
shows a deep commitment to the promotion and
development of this language by using neologisms
being necessary to describe new concepts and a
changing reality. These terms are explained at the
end of his novel.
|
Publication
Nouvelle parution
Akkin
i Wedrar de Aomar Oulamara
Aux
éditions
Achab ,
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Le
roman raconte, lit-on dans la quatrième de couverture,
l’histoire de villageois
qui ontt déserté Ubdir, leur village, pour aller rejoindre
Tala n Tidegt.
Après
Iberdan n Tissas (Editions Pas Sage, 2007), une œuvre,
livrant dans un kabyle
limpide, le parcours révolutionnaire de Messaoud Oulamara et
Tullianum (Edité
au HCA), la première œuvre romancée en kabyle, explorant un
fragment de
l’histoire millénaire des Imazighen, Aomar Oulamara publie
aux Editions Achab
une œuvre intitulée Akkin i wedrar. Le roman, car c’est d’un
roman qu’il s’agit, raconte,
lit-on dans la quatrième de
couverture, l’histoire de villageois et de villageoises
ayant déserté Ubdir,
leur village, pour aller rejoindre Tala n Tidegt. L’exode,
n’a, bien entendu,
pas été de gaieté de cœur. Le chemin qu’empruntent les
villageois ressemblent
au film de la vie (asaru n tmeddurt).
Une vie où se
mêlent tagmat
(fraternité), tismin (jalousie), Tirugza (courage), lazz (la
faim)…
A
relever que tel que nous a habitué Aomar Oulamara, la langue
de Akkin i Wedrar
est celle de
tous les jours. Autrement
dit, elle n’est pas truffée de néologie qui, a usage
démesuré, dessert la
beauté du texte.
A
propos de l’auteur :
Aomar
Oulamara est né en 1952 à Boudafal. Il est docteur d’état ès
sciences
physiques. Il a appris Tamazight à l’université d’Alger,
quand feu Mammeri y
dispensait des cours. Après
1980, il a
été enseignant à l’université de Tizi-Ouzou. Depuis 85, il
est ingénieur dans
une compagnie internationale
S.O. A
Lundi, 17 Octobre 2011
NB :
cet
ouvrage a déjà été présenté par l’auteur dans votre
revue « ayamun,
cyberlibrairie de littérature berbère »
Aux éditions
Achab ,
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Kamal Nait-Zerrad,
Mémento
grammatical et orthographique de berbère, L’Harmatan
Centre de recherche
berbère, Inalco,
ANNALES
DES ÉPREUVES DE BERBÈRE AU BACCALAURÉAT
Kabyle - Chleuh -
Rifain
1995-2009
Revue
des Etudes Berbères Volume 5_ 2010 :
Mustapha
Gahlouz :
Les Qanouns
kabyles, l’Harmatan
Ammud n
tayri war ittwarin n
Karim Kannuf
AMMUD N
TAYRI war ittwarin
Abdelmɛttaleb
Zizaɛui
(Tabridt n tghuri tamazight –tasdawt n Wejda-)
Cahrazad[15] d ammud[16] wiss kuẓ[17] n Karim Kannuf[18]. D awardi i
tenni ittexs umaru. Yus d d ameḍfuṛ i Reɛwin n
tayri :
ttmunan di telɣa d tumayt[19], maca tayri teɣza
da ugar xef min ittṛaja umeɣri.
Cahrazad, d tcuni n
arrimt d tcuni n yzli. Nettat i
icuqen ul n umaru, taqessist awarn i tqessist. Maṛṛa izlan
neddun s
tufrayt, ɛawd s uxaṛṛeṣ i di ittwala wzrawi tudart war ɣars
bu unamk mbla nettat. D ijj n ulaɣi n tayri war ittenfeliln,
n tayri izedɣen
bupbel n umaru.
Ammud a yurm s
tufrayin[20] n umedyaz, s
ucemmuḍ n umutti deg yiman id itejjan tcuni n tqessisin.
Cahrazad d taɣbalt
manis ttnessasent tiwalin, manis d ssfayn yezlan ixsen ad
qeḍwn imewwas
iqqnen tamaziɣt, imewwas a ixsen ad carfen awal nneɣ puma ad
iqqim d
atlay[21] issḍaw it
uṣemmiḍ, uca ittawy it ɣar uweḍḍaṛ…
Maca s twuri[22] n Kannuf, s
tzemmar n yezlan ittawḍn ad alsen tira i arrimet n wawal
amaziɣ,
ttawḍn ad mmlen i ywdan tcuni n tutlayt n tayri zi ireddu
wul.
Tayri deg wdlis a
tesmun jar uxeyyeq d tumert[23], jar tarẓugi
d teẓyuḍi, jar wbrid d wtlaɛ, jar da d diha, jar rexxu d
tibawt. Ameɣri iḍaffaṛ iṣuṛaf d imaynutn xef min
izwarn, nettaf axaṛṛeṣ nniḍn, nettaf awaln nniḍn
yuym iten umaru zi tala n twangimt nnes.
Asefru izdeɣ Kannuf.
Kannuf izdeɣ asefru d
manaya i ixs ad anɣ inint tqessisin, asneflul d adurri n
umaru, d tazeddiɣt,
d tudart. Amaru izdeɣ izlan, izlan zedɣen Kannuf, amn dinni
jar asn
tira, ixsen ad inint: Artum. D artum ittejjan azarwi ad yaṛu
izlan, maca
d izlan mani tayri war ttili d arrimt teddar jar imarayn[24] (necc,
Cahrazad).
Deg umeggar, tayri a
war ittwarin tzemmar ad tili d iɣɣed
i zi ɣa tekkar tmessi nniḍn id anɣ ɣa iwcn izlan nniḍn,
repriq nniḍn, udm nniḍn n wzrawi, maca deg yijj n wammud
nniḍn.
Aux éditions PENSEE :
http://www.ayamun.com/ed_Pensee.htm:
Abrid
n tala, ungal sɣur Muḥend Arkat
Aux éditions Achab ,
http://www.ayamun.com/Achab.htm
2 nouveaux
ouvrages :
Demande de
sponsoring :
Dictionnaire
de
berbère libyen_Sponsoring.pdf
Dans le giron d’une
montagne de Bahia
Amellal
Amawal n yinzan n
teqbaylit sɣur Ramḍan
At-Menṣur
Il était une fois
l’Algérie, par Nabil
Fares
Aɣyul n Ǧanǧis, sɣur
Ameziane Kezzar
Réflexion sur la
langue arabe classique de
Rachid Ali-Yahia
Les bijoutiers
d’At-Yani
Hadjira
Oubachir, Tirga n tmes, rêves de feu,
préface de
Rachid
Mokhtari
Aux éditions
« Odyssée »
:
http://www.ayamun.com/Odyssee.htm:
1 nouvel ouvrage :
Issin,
sɣur
Kamal Bouamara
ussan-a yeffeɣ-d
wedlis amaynut deg
Fransa, s tefrnansist. Aux origines du monde,
Contes et légandes de
Kabylie, sɣur Djamel Arezki.
Aux
éditions
ayamun :
Une
réédition :
iḍ
d wass, roman de
Ɛmer
Mezdad,
237 pages, Editions
ayamun 2010.
Catalogue :
http://www.ayamun.com/tidlisin.htm
Aux éditions
« tira », route de l’Université, taga-uzemmur,
Bgayet :
http://www.ayamun.com/Tira.htm
_ Mourad Zimu,
Ameddakel, tulluzin, 151
pages.
_ Ramdane
Abdenbi, Timsirin n tudert, tullizin 104 pages
– Salem
Zenia,
Tafra, ungal, 208 pages
– Ramdane
Lahseb, zik-nni deg Wat Dwala, 76 pages
– Brahim
Tazaɣart,
Amulli Ameggaz, isefra, 70 pages
– Nadjia
Bouridj Abdelllah Nouh, Haqbaylit n Tipaza, 77 pages
– Djamal
Iggui,
Ɣas ! , ammud isefra, 83
pages,
–
Kamal Bouamara, Nekni d wiyiḍ,
tullusin, 125 pages,
– Djamal
Arezki , akal d wawal, tulluzin
Aux
éditions Achab ,
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Salhi (Mohammed
Brahim). Algérie :
citoyenneté et identité. Préface de Ahmed Mahiou
Oudjedi (Larbi).
Rupture et changement
dans La colline oubliée. Préface de Youcef Zirem
Zellal (Brahim). Le roman de
Chacal. Textes présentés
par Tassadit Yacine
la fête de Kabytchous de Nadia
Mohia :
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Mraw n tmucuha sɣur
Akli
Kebaili :
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Amaynut :
Guy de Maupassant, amneṭri, une
tradcution de Ahmed
Hamim :
http://www.ayamun.com/hamoum.htm
Said Chemakh vient de
publier un recueil
de nouvelles « zik ed tura » :http://www.ayamun.com/Chemakh.htm
Aux éditions Achab,
vient de paraître
« la ruche de Kabylie » de Bahia Amellal,
préface de Karima
Dirèche
Aux éditions Achab,
vient de paraître
« lexique de linguistque français-anglais-tamaziɣt »,
de
A.Berkai :
http://www.ayamun.com/Achab.htm
Daɣen :
« Amawal s
tcawit-tafransist-taɛrabt »
de
Ounissi Mohamed-Salah, Enag éditions, alger 2003 :http://www.ayamun.com/Amawal_ounissi.htm
« Florilège de pésies
kabyles » de Boualem
Rabia, éd. L’Odyssée, 2005 :
http://www.ayamun.com/Odyssee.htm
« Mmi-s n igellil »,
tasuqilt n « le
fils du pauvre » de Mouloud Feraoun, si tefransist, sɣur
Musa
At-Taleb, éd. L’Odyssée, 2005 :
http://www.ayamun.com/Odyssee.htm
Massa
Nadia Menad
tesuffeɣ-d 4 n tmucuha i wid meẓziyen , yerna ula d wid
meqqten
zemren ad ent ɣrent. Azwel n tmuccuhua d wi :
v amcic amcum
v izem acaraf d
ubareɣ bu-tkerkas
v ṭtejra n baba-inu
ba
v tucmiţ d ugellid
azewwax.
Tazwart, i
tmucuha-ya, d Hamid Bilek i ţ-yuran. Win iran ad iwali
tidlisin n
Massa Nadia Menad, ad yeklilki deg wassaɣ :
http://www.ayamun.com/Nadia-Menad.htm
« Tibernint d ssellum »
par Ahcène Mariche
Ahcène Mariche,
toujours prolifique et
plein d’énergie, la muse ne le laisse jamais tranquille au
point où elle l’accompagne
partout.
Après avoir édité
trois recueils de
poésie en kabyle traduits en français et deux recueils de
poésie en version
anglaise le voici aujourd’hui avec deux nouvelles
publications.
Vu la rupture du
stock de ses trois
premiers recueils en occurrence Id YUKIN, TAAZZULT-IW et
TIDERRAY et la demande
persistante des ses lecteurs et fans, Ahcène Mariche a
décidé de les rééditer
dans un même recueil qui contient 90 poèmes au bonheur des
lecteurs qui
ont déjà découvert sa poésie ou ceux qui vont la
découvrir. Ahcène mariche nous
accorde encore une fois une odyssée poétique à vivre sur
168 pages de ce
recueil.
Notons que ces
poèmes sont cette fois ci
en version kabyle (tamazight) uniquement, vu que la
demande
s’est faite dans cette langue qui ne cesse d’inspirer
plein de lecteurs au
moment où certains se plaignent du manque de lectorat. (M. Mayas)
www.ayamun.com/Mariche.htm
bindeled
par Kamal Ahmane (écrit
en
danois)
Kamal
Ahmane
a exercé comme enseignant de langue française et
correspondant de presse en
Kabylie avant de prendre la tangente vers le Danemark en
2003. Imprégné de la
culture de son pays d´accueil , il franchit un pas de
l’écriture poétique dans
la langue de H.C Andersen. Son premier recueil de poésie
est sorti le mois de
novembre 2008. Ses poèmes sont exclusivement écrits en
danois. Toutefois,
et à travers certains poèmes, il rend hommage
à sa Kabylie. (A.Mariche)
TULLIANUM
– Taggara
n Yugurten, par Ulaɛmara : texte
intégral en
PDF à télécharger depuis notre rubrique
« téléchargement »
Basé
sur
des faits historiques décrits par Salluste dans le célèbre
ouvrage "La
Guerre de Jugurtha", écrit seulement quelques dizaines
d’années après la
mort de Yugurten dans le cachot du Tullianum, U Lamara
reconstitue la
trajectoire de cet homme hors du commun.
Contrairement
aux
biographies classiques, ici, c'est Yugurten lui-même qui
raconte, dans sa
langue, les évènements. C’est un récit biographique
imaginaire de Yugurten.
Cet
ouvrage
est comme une vision "miroir" des évènements décrits par
Salluste, tout au long des 14 années du combat acharné
contre Rome, dont 7 de
guerre ouverte.
La
parole
est ainsi rendue à Yugurten n At Yiles.
Tullianum
est
le nom de la sordide cellule souterraine où a été enfermé
Yugurten pendant
6 jours, après avoir été humilié dans la longue marche dans
Rome, enchaîné,
derrière le cortège triomphal du général Marius. Ses 2
enfants, arrêtés en même
temps que lui, étaient à ses côtés, enchaînés aussi....
Yugurten
raconte
les différentes étapes de la guerre d'indépendance contre
Rome depuis
la mort de son oncle Makawsen (Micipsa), les intrigues et
les combats
mémorables contre les légions romaines, les souffrances et
vertus de ses
compatriotes de lutte, mais aussi la trahison des siens.
Seul
dans
le cachot du Tullianum, nu et sans nourriture, pendant 6
jours dans le
froid de décembre de l’an -104 !
Chacun
de
nous peut imaginer ce que pouvait penser, à ce moment là, un
homme de la
trempe de Yugurten. ( auteur : Ulaɛmara)
Tuɣac timsadaɣin,
seg Aṭlas ɣer
Fromentor, tizrigin « tira »
2008,
Veus
paralleles-Tuɣac timsadaɣin
Alles d tallest ad aẓen ɣer temrayt. Ad walin udmawen
Paraîtra
très
prochainement :
Tullianum, taggara n Yugurten, un roman d Ulaâmara, ed.
Zama. Tazwart
Di 1977 nni,
di
Paris, i ufiɣ adlis n Salluste2, Tṛad n Yugurten3 /
D yiwen
umeddakwel i
yi d innan : "Maspero iznuzu idlisen zun d tikci, akken ad iqfel taḥanuţ is ussan agi d iteddun. Azzel skud ur fuken !".
Akken i
teḍra.
Ass nni kan ufiɣ d iman-iw di tḥanuţ n Maspero, ferrneɣ
d idlisen ar ad d aɣeɣ.
Isem nni n
Salluste,
sliɣ yis, ur cfiɣ lliɣ ssneɣ ayen yura neɣ ur t-ssineɣ. Salluste
ilul di tmurt n Ṛuman
deg wseggwas n -87.
Yugurten
immut di
-104. Ger tamettant (lmut) n Yugurten akw d tlalit n Salluste zran 18 iseggwasen. Mi yura
Salluste adlis "Bellum
Yugurthinum"/
Nezmer ad d
nini llan
kan 60 iseggwasen ger tamettant n Yugurten
di tazwara n -104 akw d tira n wedlis n Salluste. Tallit
n 60 iseggwasen
am zun d ulac di tira
umezruy. Di leqrun nni, tamurt ur teţbeddil udem di 60
iseggwasen,
maççi am ass-a.
Tira nni n
Salluste
tban i yi d zun d tiṭ n win illan dinna d inigi di ṭrad n Yugurten mgal
Ṛuman. Mi bdiɣ
adlis nni, ufiɣ t
zun d tawwurt i d illin zdat-i akken ad ẓreɣ amezruy n Yugurten, amezruy n Tmazɣa4. Ɣas akken iççur tiṭ, di tedyant nni ufiɣ
ixuṣ
kra. Acḥal n
tikkal i ɣriɣ
adlis nni. Yal aseggwas a t id ddmeɣ, a t ɣreɣ tikkelt neɣ
snat, syen a t serseɣ.
Tuɣal am win itessen irennu yas fad.
Yal tikkelt ẓerreɣ zdat wallen iw agellid Yugurten iteddu,
ittazzal, iferru
tilufa n tmurt is, ikat aneccab
deg imenɣi, iteddu ɣef agmer deg
wzaɣar, deg idurar, ... Taggara
ufiɣ ayen ixuṣṣen
deg wedlis nni : ixuṣ
wawal n
Yugurten.
Di 2006, di
"
Ɣas netta immut,
isem-is akw d webrid d iwwi ɣef
tmurt is, ar ass-a ddren.
Abrid is
injer seg iseggwasen nni n tṛad mgal Ṛuman. Akken ad d yuɣal wawal n Yugurten, ufiɣ llan
sin iberdan
: ateṛjem n wedlis
n Salluste
s tmaziɣt, akw d webrid
Taggara, wteɣ ad d
skefleɣ ayen izemren ad
yili deg wallaɣ n Yugurten
di
tallit nni deg yennuɣ Ṛuman, seg mi tebda armi d ass-mi tewweḍ talast n
tṛad ....
Di yal tadyant d iḥka
Salluste6, wteɣ ad d
afeɣ amek a yeg yiwen
illan d
Amaziɣ, zdat tlufa nni imir.
Di tira n
Salluste
llan sin wudmawen. Yiwen d udem umaru d iḥekkun
tadyant akken tella, wis sin d wudem Uṛumi iẓeṛṛen s
wallen n wegdud
iḥekmen ddunit
imir. Illa deg wawal "Ṛuma i d ikkan nnig akw timura !"
Di tideţ,
ma yella wugur ger sin ixṣimen,
anida yella lkil, yal yiwen ad d yeḥku
tadyant is. Akken i tferru s lḥeq.
Deg wedlis n Salluste,
di yiwet tedyant
____________________________________________
2 Salluste : Caius
Sallustius Crispus,
87 - 35 zdat Aâisa, ixdem akw d Cesar di ¨Ṛuma. Di -46,
iṭṭef
leḥkem n ¨Ṛuman di Afrika (Proconsulat d'Afrique). ¨Iţwassen
ugar s wedlis nni
yura "Bellum
Yugurthinum ...".
3 La guerre de
Jugurtha (Bellum
Yugurthinum), Salluste, édition bilingue français / latin,
les Belles Lettres,
1941 Paris, réimpression en 1974. Traduction
du latin par Alfred
Ernout.
4 Tamazɣa tella tebḍa
ɣef
sin : Tamazɣa n wagmuḍ (Tunes akw d wagmuḍ n Lezzayer) ;
Tamazɣan
utaram (Meṛṛuk akw d wmur utaram n Lezzayer). Akin
tella Libya akw d
Tiniri (seḥra)
5
6 Salluste iḥka d
amur ameqran seg
wayen iɣra deg idlisen yura C. Sulla
couvertures :
http://www.ayamun.com/Portraits.htm
Nous avons le grand
plaisir de vous
annoncer la parution de ces 3 romans en tamazight du Rif :
«n weẓru»
deSamira Yedjis,
«u jar» de Mohamed
Bouzeggou,
«iḍ yebuyehḥen» de Said
Belgherbi.
Vous
trouverez les analyses littéraires faites parAbdelmotalleb
Zizaoui, chercheur à
Oujda, dans les numéros 34 et 35 de la cyberrevue (Juillet
et Septembre 2008)
_ la
parution du roman «tiɣersi»
de Mohand Ait-Ighil
Atta
tura temdint
zdat tmuɣli n Meẓyan, s yiberdan-is iwenɛen d wid yettwaɣen
ççuren s yineqquren,
s
lebni-inesajdidd uqdim,s yimezdaɣ-is
meẓziyen
neɣ wesren. Ibedd akken kra
tegnitt yekkes-d igirru yessaɣ-it.
Mezyan
ibedd din
zdat usefreg yellan gar temdint
d lmersa. Yecmumeḥ mi yefhem d tikkelt taneggarut
anda asefreg-a a
t-id-iqareɛ. Degs
ɣer da, tella
tmurt anda
yedder, degs akkin telle tmurt
anda tettragu
tilelli. A win yeẓran ma a tt-yelḥeq walbaɛd mi
yezger akkin i
usefreg. Aṭas deg wid izegren nwan a tt-magren, mi wwḍen
ufan-n terwel. Di tmurt daɣen, ddunit
tuɣaltudert zdaxel n lḥebs
_ la parution, aux
éditions «tira», du
recueil de poésie deMaram Al-Masri tarduit de l’arabe par
Brahim Tazaghart,
sous le titre: takrisya zeggaɣen ɣef
wagen mellulen :
http://www.ayamun.com/Portraits
_ la
naissance de la collection Aru. Etudes et Textes
amazighs des
Editions Odyssée (Tizi-Ouzou). La collection s'occupe
de la publication des
études portant sur tamazight (langue, littérature et
civilisation), des manuels
parascolaire et universitaire et des textes littéraires
(traditionnels ou
modernes).«zik-nni» est première publication de cette
collection. C'est un
recueil de contes recueillis et présentés par l'écrivain
d'expression kabyle
Salem Zenia.
Salem ZENIA, yella d aneɣmas deg uymis
Le Pays/ Tamurt, seg 1990 yer 1995. S yin akkin, issuffeɣ-d aɣmis Izuran/Racines, di 1998.
Salem ZENIA,
d amaru s teqbaylit. Yura-d yakan sin n wungalen, «» (1995)
d «ɣil d wefru» (2002), d tlata n
wammuden n yisefra : «n Yidir-Les rêves de Yidir» (1993), «» (2005), d «ïtij
aderɣal» (2008). Idlisen imezwura,
ffɣen-d di
tezrigin l'Harmattan, di
tmurt n Fransa, ma d adlis aneggaru,
yeffeɣ-d di
Barceluna. Tura akka, atan ad d-issewjad ungal nniḍen.
Salem ZENIA, yewwi yakan
arraz « Apulée », d amenzu, di tira n wungal (deg
temzizelt i d-tesnulfa Temkardit taɣelnawt, 2005). Akken diɣen i d-yewwi Agerdas
n userhu
yef wayen akk yexdem i tneflit n tsekla tamaziɣt ; tefka-as-t
Tuddsa Tagraɣlant n Ustan n
Izerfan d
Yisenfullusen Imaziɣen (Tamazya), di yulyu 2005 di Lpari.
Adlis-agi d ammud n tmucuha,
n tmurt n leqbayel,
i d-yejmeɛ Salem ZENIA. Azal n wammud-agi,
izad macci d kra ; idrisen i d-yeddan deg-s d
imedyaten igerrzen
n tsekla tamensayt, yerna d inagan yef ubeddel i ihuzan timucuha n tmurt-nneɣ. Tin ɣer-s, idrisen-agi, lhan i tɣuri ; tanfalit-nsen d
tmeslayt-nsen, cebḥent, yerna deg-sen
lewsayef n uɣanib n
tmawit.
Salem
ZENIA, macci
Timucuha i d-yeddan
deg udlis-agi, ad ssedhunt win (d tin) ad tent-yeɣren, akken lhant diɣen i uselmed n tutlayt d tsekla
tamensayt n teqbaylit.
![]()
[1]
Ed. L’Odyssée, Tizi
Ouzou, 2008.
[2] Zik-nni deg Wat Dwala, Ed. Tira, Bejaia,
2009.
[3]
Les vérités de ceux qui
y croient.
[4]
Il serait judicieux de
procéder aux corrections linguistiques, et autres, qui
s’imposent pour les
rééditions futures.
[5]
P. 31.
[6]
P. 11.
[7]
L’esthétique comme
« rapport au monde sensible ».
[8]
Ce n’est pas agréable de
lire un texte littéraire avec un œil collé à un
dictionnaire ! Et pour ce
qui est de tamazight les recherches et publications
lexicographiques sont très
peu nombreuses.
[9]
P. 30.
[10]
P. 61.
[11]
« Agni n
wuffal », p. 59, par exemple.
[12]
« Aḍu
neɣ
At Waḍu »,
p. 18, par
exemple.
[13]
« Ttselbiba n yiwet n taddart », p. 54.
[14]
Ramdane Lasheb a aussi
publié en 2012 aux Editions de L’Odyssée de Tizi Ouzou un
ouvrage intitulé Autour
de la civilisation amazighe
composé de textes traitant de notre identité et de notre
mémoire collective.
[15] Caharazad : asegged n
tira : H. Banhakeia, E. Farhad &
A. Zizaoui. Tabridt n
Tvuri Tamazivt – Tasdawt n Wejda, taÇËigt tis 9, 2011
[16] Adlis
n yezlan
[17] Areboa
[18] Karim
Kannuf
d azrawi immarni deg useggwas n 1969, deg
Icumay, di temdint
n NnaäuË. –ars kËaä n wammudn : Jar wÃfeä d
usennan (2004), Reowin
n tayri (2008) d Sadu
tira… tira (2009)
[19]
Contenu
[20]
Taycit
[21]
Oral
[22]
Min itteg
[23] Refrapet
[24]
Inni ittexsen ayawya