ayamun CyberRevue de
littérature berbère
02/12/2011
Publications des Editions Achab (Tizi-Ouzou)
1Nouvelle
publication :
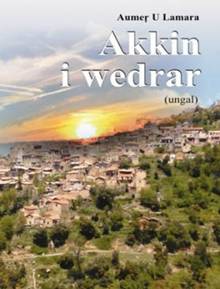
Publication Nouvelle parution
Akkin i Wedrar de Aomar Oulamara
Par S.O. A Il ya 20 heures 58 minutes | 381
lecture(s)
Le roman raconte, lit-on dans la quatrième de
couverture, l’histoire de villageois qui ontt déserté Ubdir, leur village, pour
aller rejoindre Tala n Tidegt.
Après Iberdan n Tissas (Editions Pas Sage, 2007),
une œuvre, livrant dans un kabyle limpide, le parcours révolutionnaire de
Messaoud Oulamara et Tullianum (Edité au HCA), la première œuvre romancée en
kabyle, explorant un fragment de l’histoire millénaire des Imazighen, Aomar
Oulamara publie aux Editions Achab une œuvre intitulée Akkin i wedrar. Le
roman, car c’est d’un roman qu’il s’agit,
raconte, lit-on dans la quatrième de couverture, l’histoire de
villageois et de villageoises ayant déserté Ubdir, leur village, pour aller
rejoindre Tala n Tidegt. L’exode, n’a, bien entendu, pas été de gaieté de cœur.
Le chemin qu’empruntent les villageois ressemblent au
film de la vie (asaru n tmeddurt). Une
vie où se mêlent tagmat (fraternité),
tismin (jalousie), Tirugza (courage), lazz (la faim)…
A relever que tel que nous a habitué Aomar Oulamara,
la langue de Akkin i Wedrar est celle de tous les jours. Autrement dit, elle n’est
pas truffée de néologie qui, a usage démesuré, dessert la beauté du texte.
A propos de l’auteur :
Aomar Oulamara est né en 1952 à Boudafal. Il est
docteur d’état ès sciences physiques. Il a appris Tamazight à l’université
d’Alger, quand feu Mammeri y dispensait des cours.
Après 1980, il a été enseignant à
l’université de Tizi-Ouzou. Depuis 85, il est ingénieur dans une compagnie
internationale
S.O. A
Lundi, 17
Octobre 2011
Bahia AMELLAL, Dand le giron d’une montagne :
![Description : Bahia%20Amellal[1]](Achab_fichiers/image005.jpg)
Remḍan At-Menṣur, Amwal n yinzan n teqbaylit :
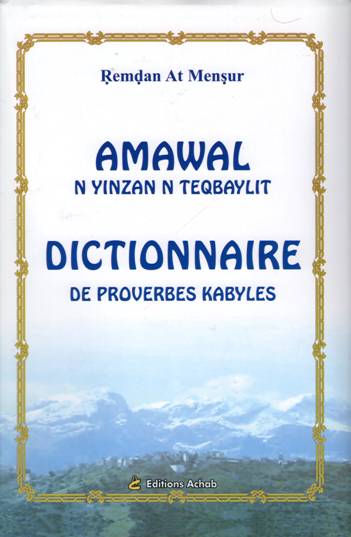
Il était une fois l’Algérie de Nabile Farès :
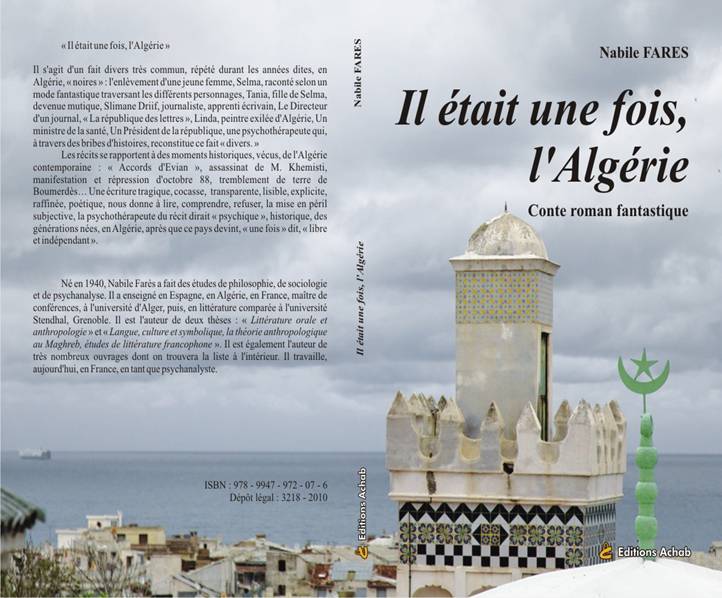
Aɣyul n Ǧanǧis sɣur Ameziane Kezzar
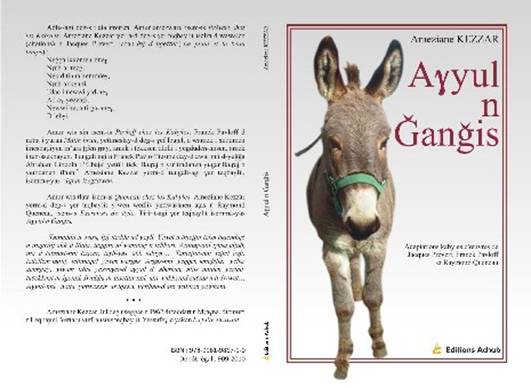
Réflexion sur la langue arabe classique de Rachid Ali-Yahia
![Description : Rachid%20Ali%20Yahia[1]](Achab_fichiers/image013.jpg)
Les bijoutiers d’At-Yani
![Description : 20bijoutiers-d'Ath-Yenni[1].jpg](Achab_fichiers/image015.jpg)
Hadjira Oubachir, Tirga
n tmes, rêves de feu, préface
de Rachid Mokhtari
![Description : Hadjira%20Oubachir[1]](Achab_fichiers/image017.jpg)
Catalogue des Editions
Achab :
Berkaï (Abdelaziz). Lexique de la
linguistique français-anglais-tamazight. Précédé d’un essai
de typologie des procédés
néologiques.
Farès (Nabile). Yahia, Pas de
Chance, un jeune homme de Kabylie (roman).
Amellal (Bahia). La Ruche de
Kabylie (1940-1975). Préface de Karima Dirèche.
Kebaïli (Akli). Mraw n tmucuha i
yiḍes. Tazwart n Kamal Naït-Zerrad.
Mohia (Nadia). La fête des
Kabytchous. Préface de Mahmoud Sami-Ali. Postface de Khalida
Toumi.
Oudjedi (Larbi). Rupture et
changement dans La colline oubliée. Préface de Youcef Zirem.
Zellal (Brahim). Le roman de
Chacal. Textes présentés par Tassadit Yacine.
Salhi (Mohammed Brahim). Algérie
: citoyenneté et identité. Préface de Ahmed Mahiou.
Salhi (Mohammed Brahim). Algérie
: citoyenneté et identité. Préface de Ahmed Mahiou
![Description : Salhi-couverture-1[1]](Achab_fichiers/image019.jpg)
Oudjedi (Larbi). Rupture et
changement dans La colline oubliée. Préface de Youcef Zirem.
![Description : Larbi%20Oudjedi[1]](Achab_fichiers/image021.jpg)
Zellal (Brahim). Le roman de
Chacal. Textes présentés par Tassadit Yacine
![Description : Chacal-1-couleur[1]](Achab_fichiers/image023.jpg)
Mraw n tmucua, sɣur Akli
Kebaili La fête
des Kabytchous, de Nadia mohia
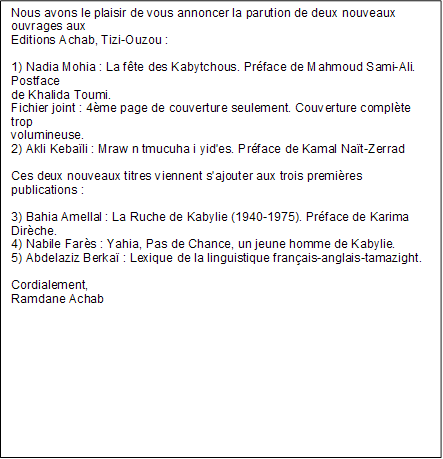
« Je mourrai pendant l’Aïd, les Kabytchous feront la
fête… » disait, quelques semaines avant sa disparition, à cinquante-quatre
ans, Abdellah Mohia, poète, écrivain et dramaturge algérien. « Les Kabytchous » : il appelait ainsi les Kabyles,
son peuple donc, un peu par dérision, beaucoup par affection. Multipliant les voix et les mises en abyme, ce livre
éclaire certains aspects de l’homme et de son génie créateur, rend compte de
son drame intime en ses dimensions les plus significatives : une
personnalité, une famille, une société, une culture, une expatriation, enfin,
plus proche d’une fuite illusoire que d’une réelle libération. Mais par la relation simple et précise des faits, par
l’implication totale de la soeur qui le tisse, le récit de la « fête »
annoncée devient aussi une recherche dont les
thèmes s’imposent d’eux-mêmes au fil de l’écriture : les liens entre la « possession » d’une mère et le cancer de
son fils aîné, le poids de la transmission entre les générations, l’innombrable
charge affective de la langue maternelle, l’autorité oppressante du grand frère,
la culture tribale et ses limites, l’exil et ses impasses... Il s’agit moins
d’analyser ou d’expliquer les choses que de les regarder telles qu’elles ont été,
telles qu’elles sont, dans leur unité complexe et profonde. D’un mot, il s’agit de comprendre
par soimême, en soi-même, ce qu’on a vécu, ce qu’on a reçu, ce qu’on
est. Cette démarche au ras des faits et de
l’expérience personnelle est d’importance et dépasse largement le « cas » particulier qui l’a
inspirée : n’est-elle pas à la source même de toute connaissance des
hommes et de leurs sociétés, de leurs cultures et de leurs maux
individuels ou sociaux ?... * Après une thèse de doctorat en psychopathologie et
psychanalyse soutenue à l’Université Paris-VII, Nadia Mohia s’est orientée
vers l’ethnoanthropologie. Son expérience anthropologique est diverse : dans sa
Kabylie natale, chez les Indiens Emérillon et Wayãpi (Guyane
française), chez les Indiens Ojibwa de Saugeen (Ontario, Canada). Ses
travaux s’inspirent donc de cette double formation, mais c’est finalement pour
dépasser les cloisonnements disciplinaires en vigueur et tenter d’approcher la
réalité humaine en son unité. * ISBN : 978-9961-9867-2-1 Dépôt légal : 3447-2009

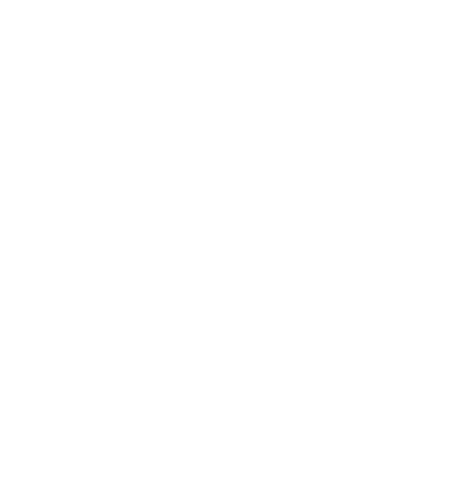
Bahia
Amellal
 La mutltiplicité des courants
et écoles en linguistique et leur caractère quasi hermétique n’ont pas
favorisé la normalisation des données, en particulier terminologiques, et
expliquent en partie la quasi-absence de terminologies bilingùes ou
multilingues dans ce domaine.
La mutltiplicité des courants
et écoles en linguistique et leur caractère quasi hermétique n’ont pas
favorisé la normalisation des données, en particulier terminologiques, et
expliquent en partie la quasi-absence de terminologies bilingùes ou
multilingues dans ce domaine.
Ce lexique trilingue de la linguistique contenant pratiquement l’ensemble
de la terminologie de ce domaine (phonétique, morphosyntaxe, sémantique,
lexicologie, sociolinguistique, psycholinguistique...) constitue donc un
outil original et nécessaire de décodage (compréhension) et d’encodage
(production et traduction) de textes linguistiques pour francophones,
anglophones et berbérophones. La langue berbère qui est introduite dans ie
système d’enseignement dans ses différents paliers, depuis quelques années,
particulièrement en Algérie et au Maroc, ne dispose pas encore d’une
terminologie exhaustive de la linguistique à même de permettre cet
enseignement dans cette langue. Ce lexique vient donc à point nommé combler
cette lacune et établir des passerelles de communication, dans ce domaine
particulier, entre le berbère, le français et l’anglais.
Abdelaziz Berkaï est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en
mathématiques (DES) de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et d’un
magistère de langue et culture amazighes de l’Université de Béjaïa où il
enseigne depuis 2002, notamment les modules de phonétique/phonologie et
sociolinguistique. Il prépare actuellement un doctorat en lexicographie bilingue
français-tasaḥlit (parler d’Aokas).
« La
ruche de Kabylie » de Bahia Amellal, préface de Karima Dirèche « Lexique
de linguistque français-anglais-tamaziɣt » de A.Berkai
 En
1873, des Pères Blancs chargés d’une ambitieuse mission, sont en Kabylie. L’école
et le dispensaire, improvisés à la hâte, attirent des kabyles en leurs
seins. Le greffon, non toléré à ses débuts, a finalement pris dans le corps
kabyle où l’école et les soins s’avèrent vitaux. Cette aventure longue d’un
siècle et dont je ne commenterai pas l’issue religieuse, a pour conséquence
un emprunt culturel. Les élèves ont en effet int gré l’ouvroir, le camp
scout puis la Ruche où ils se sont emparés d’une langue nouvelle, ont
acquis un savoir-faire, appris le sens de l’organisation, exercé des
activités intellectuelles, adopté une pensée universelle dépassant les
frontières des montagnes qui font obstruction à tout horizon. Cette
formation, parfois à cachet occidental, n’a pas détourné le Kabyle de sa
propre culture. certains des bourgeons ont éclos
plus tard pour honorer leur identité. Fathrna Ath Mansour est l’une des
premières femmes Kabyles à détenir un Certificat de fin d’études. Plus
tard, “Fouroulou” usera sa gandoura sur les bancs des Pères et s’initiera
aux joies des camps. D’autres, très nombreux, ont Constitué le soutien d’une
Algérie nouvelle. Si le scoutisme n’a pas de spécificités propres à la
région, la Ruche demeure une création des plus originales, propre à la
Kabylie.
En
1873, des Pères Blancs chargés d’une ambitieuse mission, sont en Kabylie. L’école
et le dispensaire, improvisés à la hâte, attirent des kabyles en leurs
seins. Le greffon, non toléré à ses débuts, a finalement pris dans le corps
kabyle où l’école et les soins s’avèrent vitaux. Cette aventure longue d’un
siècle et dont je ne commenterai pas l’issue religieuse, a pour conséquence
un emprunt culturel. Les élèves ont en effet int gré l’ouvroir, le camp
scout puis la Ruche où ils se sont emparés d’une langue nouvelle, ont
acquis un savoir-faire, appris le sens de l’organisation, exercé des
activités intellectuelles, adopté une pensée universelle dépassant les
frontières des montagnes qui font obstruction à tout horizon. Cette
formation, parfois à cachet occidental, n’a pas détourné le Kabyle de sa
propre culture. certains des bourgeons ont éclos
plus tard pour honorer leur identité. Fathrna Ath Mansour est l’une des
premières femmes Kabyles à détenir un Certificat de fin d’études. Plus
tard, “Fouroulou” usera sa gandoura sur les bancs des Pères et s’initiera
aux joies des camps. D’autres, très nombreux, ont Constitué le soutien d’une
Algérie nouvelle. Si le scoutisme n’a pas de spécificités propres à la
région, la Ruche demeure une création des plus originales, propre à la
Kabylie.
Cet ouvrage permet d’entrouvrir une fenêtre sur un pan méconnu de notre
société.Bahia Amellal-Saheb est spécialisée en Virologie. A Alger, elle
obtint le diplôme de magister en Biologie moléculaire et en Angleterre, le
diplôme de docteur en virologie.