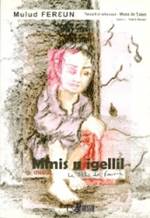Editions Odyssée
ayamun
CyberRevue de littérature berbère
|
Editions Odyssée |
Issin, sɣur Kamal Boauamar, ed l’Odyssée, 2010
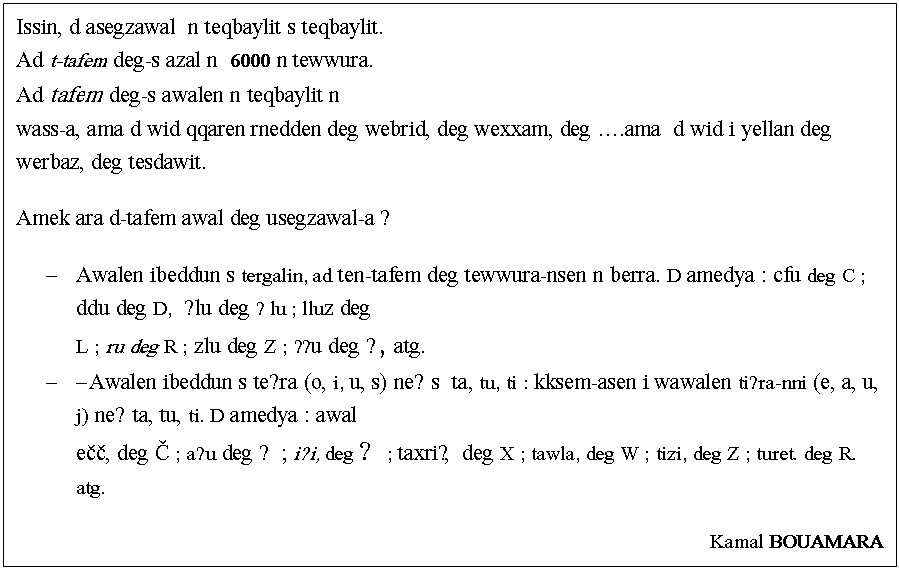
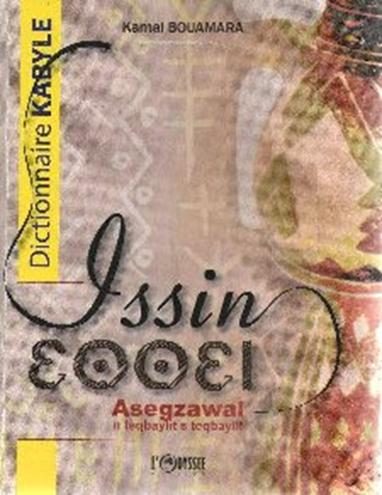
« Florilège
de pésies kabyles » de Boualem Rabia, éd. L’Odyssée, 2005 :
« Car n’est-il pas sacrilège de laisser s’étioler un printenps sans en avoir recueilli la semence future ? Ce
corpus de vers (chantés pour la
plupart) sent la vérité
d’être, le feu de l’inspiration spontanée
à la fois singulière et plurielle.
Chez nous, qui dit ètre, dit
poésie, car celle-ci dit celui-là
qui lui ouvre le sens.
Le rude montagnard kabyle aux jarrets d’acier s’est indissociablement
attaché à sa terre qui, bien qu’ingrate, sera louée. Il la
chante, elle et ses avatars, par un verbe à la fois éloquent, juste et pathétique. Un verbe matrice qui ne cesse de déclamer et d’informer tous les courants de la vie traditionnelle (d’un ordre qui
parfois n’est plus) aujourd’bui supplanté
par de nøuvelles habitudes dites « modernes » ; verbe qui déplore souvent une société dont l’harmonie aura été dénarurée. II s’agit d’un patrimoine acnestral consistant et
persistant tel l’olivier qui s’accroche
aux ravins vertigineux de la Kabylie, qui Boualem Rabia
plie mais ne rompt pas, dont
les racines sont coordonnées à celles du pays dont il est vigile. »
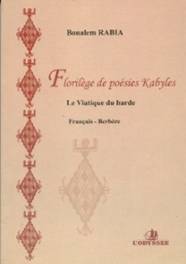
« Mmi-s n
igellil », tasuqilt n « le fils du pauvre » de Mouloud Feraoun, si
tefransist, sɣur Musa At-Taleb, éd. L’Odyssée, 2005 :
Dans cette entreprise de rehabilitation de la langue
berbere en general et du kabyle en particuLier qui, mieux, que l’œuvre de
Mouloud FERAOUN, se prête à l’exercice de traduction ? Certains parlent même de travail de
restitution tant le texte de Fouroutou respire partout la Kabytie mais
aussi la langue kabyle. Les lecteurs kabyles du « fils du
pauvre » ou des « chemins qui montent » se retrouvent
aisément non seulement en raison des scènes et tableaux familiers auxquels
ils ont affaire, mais également en raison d’une langue française au travers
de laquelle défile en filigrane la langue kabyle : formules consacrées,
locutions idiomatiques tirées du terroir et d’autres repères linguistiques
jettent des ponts entre deux cultures à la manière de l’écrivain lui-même
situé dans un évident déchirement à la jonction de deux mondes, deux
civilisations dont il a voulu être le lien solidaire. Cette fidèle dualité
lui a valu non seulement des inimitiés, mais aussi fatalement l’irréparable
verdict de l’extrémisme ayant conduit à l’assassinat l’écrivain humaniste.
Amar Nait Messaoud (Dépêche de
Kabyliie)